

« Peut-être qu’avec toutes les difficultés que l’Empire vous a créées, nous perdons de vue le moment historique et ce que vous êtes en train de construire ici et qui n’existe nulle part ailleurs en Amérique latine » : Ramon Grosfoguel, un des principaux penseurs décoloniaux du continent, s’adresse à un autogouvernement populaire du Venezuela, le 20 avril 2023 (photos). Avec d’autres intellectuel(le)s et chercheur(se)s latino-américain(e)s tels que Katya Colmenares, Enrique Dussel, Juan José Bautista, Rafael Bautista, José Romero Lossaco ou Karina Ochoa, il suit de près l’expérience de démocratie participative au Venezuela, alliant visites de terrain, conférences et ateliers de formation. Grosfoguel partage l’analyse du Mouvement des Sans Terre du Brésil, présent sur place avec ses équipes, qui voit dans la commune vénézuélienne un exemple stratégique, nécessaire, pour l’ensemble de la région. « Vous, les communardes et les communards, êtes au cœur de la décolonisation du Venezuela et de l’Amérique latine. Vous vivez un moment historique de possibilités qui n’existent pas en dehors du Venezuela. La commune est l’alternative au projet civilisateur de la mort. Il faut avoir une vision critique du socialisme du 20e siècle, afin de ne pas reproduire ses erreurs. Je suis certain que nos ancêtres, ceux qui ont donné leur vie pour cet idéal, pour ce projet de société nouvelle au 20e siècle, nous disent : « Hé, regardez d’un œil critique ce que nous avons fait ».
Pour le penseur portoricain, la commune doit être consciente de la question écologique. Il est contradictoire de continuer à reproduire l’imaginaire capitaliste du « développement » et d’appliquer les mêmes technologies du projet moderne/colonial. Aujourd’hui, la cosmologie moderne met la vie en échec ».





Pour mieux connaître la vision de Ramon Grosfoguel, nous publions ci-dessous l’interview réalisée en avril 2023 par José Ernesto Narvaez pour La Jiribilla (Cuba).
« J’ai rencontré Ramón Grosfoguel lors d’un événement au Venezuela. Ouvert et bavard, nous avons rapidement tissé des liens et j’ai pu, au cours de longues promenades dans les rues de Caracas, confronter nos idées et en apprendre un peu plus sur ses réflexions concernant diverses questions d’actualité. Son statut de Portoricain – il est né à San Juan en 1956 – l’a amené à aborder, comme problème central, la question du colonialisme et du néocolonialisme, ainsi que la recherche d’alternatives à ces modèles de domination. Il combine actuellement son enseignement à l’université de Berkeley, en Californie, avec une vaste activité politique et une œuvre littéraire abondante, qui font de lui l’un des penseurs essentiels du riche panorama intellectuel du continent.
José Ernesto Narvaez – Il est clair que nous assistons aujourd’hui – en Amérique latine et dans toute cette partie du monde qui a été une colonie et qui a émergé dans une large mesure comme une république médiatisée, avec d’importantes limitations en termes de liberté politique – à un nouveau projet colonisateur qui vise non seulement à la colonisation directe des sociétés et des individus, mais qui a aussi dans la conscience l’un de ses points fondamentaux. Toute colonisation a la conscience comme point fondamental, mais il semble que le projet de colonisation contemporain privilégie la domination de la conscience des sujets par rapport à d’autres aspects. Quels sont vos critères à cet égard et quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle configuration du monde néocolonial d’aujourd’hui ?
Après les premières indépendances, la décolonisation de nos pays est restée inachevée, parce qu’il restait beaucoup de hiérarchies de domination qui n’avaient pas été surmontées. C’est pourquoi, dans la deuxième déclaration de La Havane, lorsque Fidel parle de la deuxième émancipation ou de la deuxième indépendance, il attire l’attention sur la nécessité de résoudre maintenant ce qui n’a pas été résolu lors de la première émancipation. Parmi les choses qui n’ont pas été résolues, il y a évidemment la néo-colonisation économique, politique et culturelle de nos peuples. Nous sommes passés de colonies espagnoles dans une grande partie de l’Amérique latine à des néo-colonies britanniques dans un premier temps, et à des néo-colonies américaines dans un second temps. La division internationale du travail entre le centre et la périphérie et les formes de domination néocoloniales se poursuivent encore aujourd’hui.
En termes de domination raciale, de domination patriarcale, de domination de classe, de domination capitaliste et coloniale, de domination épistémologique. En termes épistémologiques et culturels, nous nous retrouvons avec des mentalités eurocentriques, qui considèrent toujours l’Europe comme le savoir supérieur, qui doit être importé ici. En d’autres termes, nous importons des théories d’autres parties du monde et nous rejetons les théories qui ont été produites sur notre continent pour penser la libération de nos peuples. Aujourd’hui, ce phénomène a atteint des niveaux stratosphériques, car les réseaux sociaux, les nouvelles technologies et les algorithmes des médias sociaux façonnent l’opinion publique, les goûts, etc. de manière impressionnante. Les gens ne se rendent même pas compte du nombre de choses qui circulent dans ces réseaux et qui permettent aux algorithmes d’apprendre à connaître votre personnalité, vos goûts et vos caractéristiques, et à travers eux, ils commencent à insérer des messages et des significations qui renforcent chaque jour la colonisation mentale.
José Ernesto Narvaez – Dans l’une des conversations que nous avons eues ces jours-ci, vous avez dit qu’on ne pouvait pas parler de décolonisation sans parler du problème de l’impérialisme. Je profite de l’occasion pour vous interroger sur un débat au sein de la gauche, entre ceux qui ont encore tendance à interpréter l’impérialisme dans le sens donné par Lénine dans son ouvrage L’impérialisme. Stade supérieur du capitalisme, et d’autres secteurs qui soutiennent que le XXe siècle et jusqu’à présent le XXIe siècle ont représenté une transformation importante de l’impérialisme, non pas dans son essence, mais dans les formes dans lesquelles il s’exprime et se projette. J’aimerais donc que vous me parliez de la nature de l’impérialisme aujourd’hui et de la manière dont la relation impérialisme-colonialité est configurée dans le monde contemporain.
D’un côté, il y a la gauche qui pense que l’impérialisme a disparu. C’est une gauche qui se retrouve toujours dans des positions de droite, dans la social-démocratie ou des choses de ce genre. Une bonne partie de la gauche latino-américaine en est malheureusement là aujourd’hui, et c’est pourquoi elle dérape au Venezuela, à Cuba, etc. Ils dérapent parce qu’ils pensent que l’impérialisme appartient au passé, ils supposent que les problèmes de Cuba et du Venezuela aujourd’hui n’ont rien à voir avec un blocus impérialiste, mais avec un mauvais gouvernement ou une dictature. En d’autres termes, ils sont des proies faciles pour les fake news et les mensonges qui circulent sur les réseaux.
Il y a une autre gauche, plus orthodoxe, qui regarde Lénine comme si rien n’avait changé depuis. Nous devons parler, par exemple, des choses dont Lénine a parlé à propos du capital financier, de la fonction du capital bancaire-industriel, qui définit le capital financier, et de la manière dont celui-ci s’est considérablement autonomisé dans les États. En d’autres termes, le capital financier d’aujourd’hui, et les bourses, investissent, font entrer et sortir de l’argent du monde, presque sans restriction, surtout depuis que le modèle néolibéral a déréglementé les marchés mondiaux. Nous avons un capital financier vorace, dont la logique d’accumulation le conduit à faire des choses impensables à l’époque de Lénine. Ils démantèlent les industries, vendent les pièces et spéculent ensuite sur les marchés financiers. Les niveaux de spéculation que nous connaissons aujourd’hui sont énormes. Il y a des bulles financières qui font que le capital financier gagne de l’argent d’une manière tout à fait artificielle, détachée de la production matérielle. Nous voyons cela partout. Grâce aux nouvelles technologies, ces choses se produisent en quelques secondes. Ce qui prenait des jours d’investissement se fait aujourd’hui en quelques secondes. En d’autres termes, on peut quitter un pays sans investissement du jour au lendemain et réinvestir une somme d’argent ailleurs dans le monde en quelques secondes. En termes de mobilité du capital, le temps et l’espace ont été comprimés.
Nous sommes dans une phase de déclin impérial, une phase où une partie importante des élites mondiales, représentées à Davos, se rendent compte que le système va s’effondrer. Et elles savent que si le système s’effondre, elles tomberont avec lui. Ils réinventent de nouvelles dystopies et réfléchissent à la manière dont ils pourront rester au sommet si le système s’effondre. Ils inventent un nouveau système historique, que je qualifierais de pire que le capitalisme, avec de nouvelles technologies. C’est ce que certains ont appelé le techno-féodalisme, et que d’autres appellent le capitalisme numérique. Ceux qui soutiennent l’idée du techno-féodalisme affirment que ce qui se passe, c’est que, tout comme dans les marchés féodaux le seigneur féodal devait payer un loyer usuraire pour utiliser l’espace du marché, aujourd’hui les grandes plateformes numériques fonctionnent comme le seigneur féodal, qui loue un espace dans l’univers numérique et vous fait payer un loyer comme dans le marché du Moyen-Âge. En d’autres termes, les profits des capitalistes sont limités, car il existe un seigneur féodal qui, pour vendre votre marchandise aujourd’hui, vous fait payer un espace sur ses plateformes numériques. C’est le cas d’Amazon, de Google, de toutes ces plateformes numériques par lesquelles la vente de biens est canalisée à l’échelle mondiale, et qui fonctionnent selon une logique qui commence à contredire la logique du capitalisme classique.
Dans son étude de la transition du féodalisme au capitalisme, Wallerstein remet en question les récits marxistes et wébériens classiques, selon lesquels le capitalisme est né d’une classe commerciale bourgeoise, née dans les villes et qui, au fil du temps, a concurrencé l’aristocratie féodale des campagnes, notamment par le biais de révolutions politiques qui ont écarté cette aristocratie féodale du pouvoir et ont progressivement imposé le système capitaliste. Selon Wallerstein, face à la crise terminale du système féodal au XVe siècle, l’aristocratie féodale, qui savait que son destin était lié à celui du système, a inventé un nouveau système historique. Elle a résolu la crise du féodalisme par l’expansion coloniale européenne et a ainsi créé le système capitaliste mondial. Cette aristocratie féodale est alors devenue le capital financier du XVIe siècle.
Selon Wallerstein, si nous examinons les familles bancaires et le capital financier de la conquête, tant de l’État espagnol dans les Amériques que du Portugal et plus tard de la Hollande, il s’agit des mêmes familles de l’aristocratie féodale, qui ont été recyclées avec l’expansion coloniale et sont devenues des capitalistes financiers. Elles sont ensuite remplacées par les sociétés transnationales, qui constituent déjà un capital monopolistique et ne fonctionnent pas comme une famille, parce qu’il s’agit d’un autre niveau de capitalisme. C’est dans ce sens qu’il faut lire Lénine.
José Ernesto Narvaez – Mais à l’époque de Lénine, le grand capital financier était encore largement associé à l’État-nation au sens traditionnel du terme.
En effet, pour se développer, il avait besoin de l’appareil militaire. C’est pourquoi les Britanniques, les Néerlandais et tous ces empires avaient ces sociétés semi-privées qui fusionnaient avec l’État et l’armée. En ce sens, ils étaient très dépendants de leur État pour faire face à l’expansion coloniale.
L’argument de Wallerstein est qu’après l’aristocratie féodale du 15e siècle, un nouveau système historique a été inventé, pire que le féodalisme, à savoir le capitalisme mondial, le capitalisme historique. Il dit que nous sommes maintenant à un moment – et il l’a signalé dans les années 1980 – où, entre 2020 et 2050, nous entrerons dans un cycle qu’il appelle une bifurcation, dans lequel ce système et ses mécanismes de reproduction, vieux de plus de 500 ans, atteindront une crise terminale. Il n’était pas possible pour le système de se reproduire à nouveau. Par exemple, l’un des mécanismes que le capitalisme utilise pour résoudre ses crises est de s’étendre à d’autres territoires. Aujourd’hui, avec tous les territoires de la planète couverts, il n’y a plus de place pour l’expansion. Autre exemple, avec les crises écologiques, le coût des matières premières augmente et le capitalisme ne peut plus produire de plus en plus à bas prix. Tout est de plus en plus cher. Le coût du développement ne peut donc pas être répercuté sur les autres.
Les coûts de l’eau, du pétrole, de la nourriture – qui étaient supportés par les pays du tiers monde – et les coûts de la défense – qui étaient supportés par les États – doivent maintenant être payés par le grand Capital. Les États ne sont plus en mesure de défendre leur capital où qu’il se trouve, mais le capital lui-même est obligé d’avoir une armée privée et de payer pour la sécurité.
José Ernesto Narvaez – Et cela vaut aussi pour l’État états-unien dans sa relation avec le grand Capital ?
Oui, la plupart des guerres que les États-Unis ont menées à l’étranger sont privatisées, avec des sociétés de mercenaires comme Blackwater. En d’autres termes, ils versent beaucoup d’argent au complexe militaro-industriel américain pour couvrir les coûts des guerres. En réalité, ceux qui bénéficient de ces guerres sont les entreprises de ce complexe militaro-industriel, les compagnies pétrolières, comme dans le cas de l’Irak, de la Libye, etc. D’une manière générale, le coût de la reproduction et de la production du capital est hors de contrôle avec la crise écologique.
Il y a un autre élément que Wallerstein a souligné : la question idéologique, la crise de l’idéologie du progrès. Les gens ne croient plus que s’ils travaillent pendant 30 ans, leur situation s’améliorera. Cela signifie que les gens veulent que leurs demandes sociales soient satisfaites immédiatement, ce qui exerce une pression insoutenable sur le système. Il a mentionné une série de mécanismes et montré comment le système arrive à un moment de bifurcation et de crise terminale. La bifurcation, parce qu’elle peut aller dans un sens ou dans l’autre, est imprévisible. Elle peut s’améliorer si les mouvements anti-impérialistes et les mouvements sociaux hégémonisent cette transition et mènent le processus vers un nouveau système historique plus démocratique et plus juste, ou si les élites donnent au système une porte de sortie en créant quelque chose de pire.
À Davos, nous assistons à une transition dans laquelle ils envisagent une dystopie. Ils reconnaissent la crise écologique, mais ils la comprennent dans un sens malthusien : le problème n’est pas le système, mais la surpopulation, et la solution consiste donc à réduire la population mondiale. Ces écofascistes proposent de réduire la population mondiale de huit milliards d’individus à deux milliards. Pour eux, il y a six milliards de personnes à épargner. Ils identifient les problèmes, mais les solutions sont génocidaires. Ils envisagent ce qu’ils appellent le new reset, ils en ont parlé au Forum 2021. Il s’agit de la réduction de la population mondiale, des nouvelles technologies comme forme de contrôle des désirs des gens, d’un gouvernement mondial, etc. Ils envisagent même ce qu’ils appellent le transhumanisme, c’est-à-dire la robotisation de l’homme, l’amélioration artificielle de toutes nos capacités. Ils dépassent déjà la question de l’humain pour passer à la robotisation de l’humain. Ils transcendent déjà l’humain et passent à la robotisation de l’humain. Dans les dystopies de cette élite, c’est l’avenir de l’humanité qui est en jeu. Car dans cette crise terminale et cette bifurcation à venir, que Wallerstein a annoncées il y a quelque temps, cette élite veut faire ce que l’aristocratie féodale du 15e siècle a fait et se recycler dans un nouveau système, pire que celui-ci, où elle reste au sommet. Il n’y a pas encore de langage clair pour nommer ce système, mais il dépasse déjà le capitalisme à bien des égards ; ils n’envisagent même plus la concurrence pour les marchés, mais le contrôle technologique des plateformes numériques, le contrôle des désirs et de la consommation des gens, le contrôle de leurs pensées. La technologie existe déjà pour cela, et ils sont déjà très sérieux à ce sujet.
Une autre partie de l’élite impérialiste mondiale est nationaliste ; son processus d’accumulation du capital ne concerne pas tant le capital financier. Cette élite est représentée par quelqu’un comme Trump. Leur processus d’accumulation matérielle dépend beaucoup de l’État-nation, du territoire où ils investissent leur argent. Les dystopies des mondialistes ne les intéressent pas. Les deux élites sont fascistes, ne vous y trompez pas, ce qui se passe, c’est que les mondialistes nous embrouillent. Trump ne génère pas de confusion, Marine Le Pen ne génère pas de confusion, ce sont des fascistes nationalistes qui veulent protéger leurs capitaux de l’impulsion dévorante du capital financier mondial.
Et puis il y a des élites nationalistes d’extrême droite qui veulent protéger leur nation, leur territoire. C’est le conflit actuel entre les différentes factions des élites capitalistes dans le monde. Ces deux factions se disputent l’avenir du monde. Un projet multipolaire s’oppose à ceux qui veulent un gouvernement unique, l’unipolarité, etc. Et bien sûr, l’armée impérialiste a été jusqu’à présent fondamentale pour cette élite mondialiste, car c’est elle qui va de l’avant dans la réalisation de ses projets de domination. Par exemple, la guerre en Afghanistan. Ils savaient qu’ils ne la gagneraient pas. Il s’agissait d’un marché d’armes. Cela devient très cynique, car il ne s’agit même pas de gagner les guerres, mais de les faire durer assez longtemps pour gagner plus d’argent. C’est la logique de ces entreprises. Si vous tuez des millions de personnes, cela n’a pas d’importance, et c’est ce qu’elles ont fait ces 20 dernières années au Moyen-Orient.
Nous sommes dans une situation de crise systémique, qui peut avoir des conséquences dangereuses pour l’Humanité, comme la guerre nucléaire, les dystopies de ces élites mondialistes – qui projettent de créer un nouveau système historique au prix du sacrifice de six milliards d’êtres humains – ou une crise écologique catastrophique. Un nouveau système n’a pas encore émergé, mais nous sommes dans la lutte pour l’émergence de ce nouveau système. Les 20 prochaines années sont décisives.
José Ernesto Narvaez – En substance, les deux projets répondent à une logique plus large de domination impériale. Soit par les États-nations renforcés, soit par le capital financier transnational, qui a un caractère beaucoup plus liquide, mais qui a toujours des intérêts de domination très concrets. Il est clair qu’il y a une lutte entre les deux groupes d’intérêts : ceux qui trouvent dans l’État-nation la base de leur reproduction et ceux qui, au contraire, cherchent à affaiblir l’État-nation traditionnel afin d’obtenir un flux de capitaux plus important et plus rapide.
Moins il y a de souveraineté, mieux c’est pour les mondialistes. Plus il y a de souveraineté, mieux c’est pour ceux qui dépendent de l’État-nation. C’est là que réside le conflit des élites du système.
José Ernesto Narvaez – Cette lutte prend également des formes politiques concrètes. Dans des processus tels que la guerre en Ukraine, ce n’est pas seulement l’hégémonie d’un État-nation spécifique qui est négociée, mais aussi l’hégémonie de certains groupes et intérêts financiers qui émergent dans le monde contemporain et qui sont des alternatives à ceux du grand capital occidental. L’exacerbation des contradictions que nous observons en Europe et en Asie est également le reflet de l’opposition entre les nouveaux et les anciens acteurs économiques et nationaux du monde contemporain.
Exactement. Dans ce dilemme unipolaire-multipolaire, je suis de ceux qui affirment que même si ce monde multipolaire est problématique, parce qu’il reste capitaliste et contradictoire, je le préfère au monde unipolaire. Au moins, dans ce monde multipolaire, il y a un certain respect de la souveraineté des peuples et des marges de manœuvre, contrairement au monde unipolaire. Le monde unipolaire ne fait que sanctionner, bloquer, envahir, parce que c’est la volonté du système impérialiste occidental. Le monde multipolaire crée des relations à l’échelle internationale qui, au moins, offrent une marge de manœuvre permettant à des pays comme Cuba et le Venezuela de se débarrasser du blocus impérialiste états-unien et d’avoir des relations alternatives avec d’autres pays. Cela permet de radicaliser les transformations politiques. Les Chinois, par exemple, n’ont pas de projet universaliste. Ils négocient avec les pays sans s’intéresser à leur mode de pensée, leur religion, leurs coutumes, etc. L’Occident pille et se mêle aussi de ces questions. Il y a une ingérence permanente dans la souveraineté des peuples qui entrave le potentiel révolutionnaire. D’autre part, cet autre monde, s’il parvient à voir le jour, peut ouvrir un espace pour les luttes socialistes et anti-impérialistes dans le monde, qui n’existe pas pour le moment.
José Ernesto Narvaez – Dans l’environnement latino-américain, il existe de nombreux projets clairement sociaux-démocrates, mais masqués derrière un discours à caractère social qui se présente comme une alternative à la domination impériale dans la région et qui finit en fait par être organique à cette domination. Est-il donc possible d’être anticolonial sans projet anti-impérialiste ?
Non, c’est impossible. Il y a tout un débat à ce sujet, parce qu’il y a un secteur des réseaux décoloniaux en Amérique latine qui ne considère pas la lutte anti-impérialiste. En fait, il croit que l’impérialisme a disparu ou qu’il s’agit de quelque chose d’abstrait. Ils ne se rendent pas compte que l’économie politique de tous nos pays, y compris Cuba et le Venezuela, est fortement constituée par le système impérialiste mondial. Il n’y a pas moyen d’y échapper. C’est pourquoi je dis toujours que tout anti-impérialiste n’est pas décolonial, mais que tout décolonial doit d’abord être anti-impérialiste. Sinon, de quoi se décolonise-t-on ? C’est le système mondial impérialiste qui produit la multiplicité des formes de domination : capitaliste, patriarcale, classiste, eurocentrique, environnementale, et j’en passe. Cela vient de ce système impérialiste. Ce système ne sera pas vaincu sans une lutte contre lui. Lutter contre l’impérialisme de manière abstraite, sans comprendre qu’il s’agit d’une structure de domination économique et politique réelle, aboutit à une attitude spiritualiste new age qui ne change rien. Il faut un projet anti-impérialiste, avec une orientation décolonisatrice, pour faire culminer tout ce qui n’a pas été conclu lors de la première indépendance.
José Ernesto Narvaez – Vous venez d’un pays qui est une colonie. Vous avez la chance d’être assez proche de la révolution bolivarienne au Venezuela, ce qui vous a permis de connaître l’expérience d’un pays qui, vivant d’un passé néocolonial, tente consciemment de rompre avec ce passé. Par ailleurs, vous vivez aux États-Unis, au cœur même du capitalisme contemporain dans ses deux projets de domination. Comment voyez-vous, dans ces différentes réalités, le projet de domination coloniale chez le sujet colonisé ? Comment le colonialisme est-il vécu et projeté chez un sujet colonial comme le Portoricain, chez un sujet qui fait partie d’une révolution qui tente de transformer cette réalité ? Comment est-il projeté chez les sujets qui vivent au sein même des sociétés du capitalisme développé, qui sont également victimes de cette structure de domination et d’asservissement ?
Dans le cas des États-Unis, sa projection n’est pas si différente de celle des pays de la périphérie. Les désirs et les aspirations consistent à consommer davantage. C’est le modèle de réussite qui est inculqué aux pays de la périphérie. Le sens de la vie consiste à consommer davantage, et c’est ce que l’on constate aux États-Unis et à l’extérieur. Aux États-Unis, les expériences de la colonisation sont diverses. Il y a les Indiens d’Amérique qui vivent dans des conditions de grande pauvreté, d’abandon, de problèmes sociaux, d’alcoolisme, de drogue, etc. Si l’on considère les populations afro-américaines, coincées dans les ghettos des grandes villes américaines, on constate qu’elles sont victimes d’une violence continue et brutale de la part des appareils répressifs de l’État. Il en va de même pour les communautés latinos. Nous avons des personnes appauvries qui optent idéologiquement pour le système capitaliste impérialiste ; qui pensent que vivre bien signifie consommer plus et posséder plus. C’est quelque chose qui se produit à l’échelle mondiale ; ce n’est pas particulier à un sujet colonisé à l’intérieur des États-Unis. Ce qui est particulier à un sujet colonisé aux États-Unis, c’est que, par exemple, le concept de blancheur est assez restrictif. Ce qui est blanc en Amérique latine ne l’est pas aux États-Unis ; cela appartient au groupe des Latinos ou des Hispaniques, et c’est une catégorie raciale. Cela signifie que l’on sera discriminé en tant que sujet racialisé au sein de l’empire. L’idée que le racisme est une couleur de peau s’effondre dans le système américain, car le concept de blancheur est un concept d’exclusion construit culturellement et politiquement. Ainsi, de nombreux Latino-Américains qui vivent le privilège racial d’être blancs dans leurs pays respectifs se retrouvent, lorsqu’ils franchissent la frontière, face à des réalités qu’ils n’ont jamais vécues, telles que l’infériorité raciale. Cela a toute une série de conséquences dans les relations avec la police, lorsque vous sortez dans la rue, lorsque vous faites vos courses dans un supermarché ; vous êtes soumis à des niveaux de violence que vous n’avez pas connus dans votre pays d’origine.
Il existe une relation complexe entre la classe et la race. Si vous êtes un travailleur et que vous n’êtes pas blanc, cela a des conséquences économiques et politiques plus importantes. De même, un petit entrepreneur peut être victime de discrimination parce qu’il n’est pas blanc. Il y a un certain niveau à ne pas dépasser. Cela pose un problème complexe aux États-Unis, différent de celui des pays d’Amérique latine.
D’autre part, les luttes de libération sont compliquées, car elles se déroulent à l’intérieur de l’empire. Des changements démographiques très importants se produisent actuellement aux États-Unis. Le pays évolue vers une situation où les Blancs deviennent une minorité démographique. Les majorités vont être constituées par ceux qui sont maintenant des minorités, et au sein de ce groupe se trouvent les Latinos, qui connaissent actuellement une croissance exponentielle. D’où l’obsession de Trump pour la frontière. Dans 15 ans, les Blancs deviendront une minorité démographique dans le pays. C’est déjà le cas dans certains États. Cela a un potentiel, je ne dis pas automatiquement, mais c’est le cas. Il peut y avoir un changement révolutionnaire possible pour transformer l’empire de l’intérieur, avec un changement démographique de ce type. Cela nécessite une organisation politique, un changement de subjectivité, etc., afin que cette croissance démographique des non-Blancs ait des répercussions politiques anti-impérialistes. Il y a là un potentiel de travail politique important.
Cela dépend de la transformation de la subjectivité et il y a beaucoup à faire alors que les Blancs deviennent une minorité démographique dans leur propre pays. Cela pourrait changer le monde de manière très significative, si les États-Unis devaient disparaître en tant qu’empire en raison d’une révolution politique à l’intérieur du pays. J’ai écrit un article en 2005 ou 2006, intitulé « Les Latinos et la décolonisation de l’empire américain au 21e siècle », qui traitait des changements démographiques et politiques. Il y a un potentiel de transformation anti-impérialiste, et c’est pourquoi aujourd’hui il n’est plus possible de concevoir une lutte anti-impérialiste comme avant. Il faut penser à une lutte anti-impérialiste à l’extérieur et à l’intérieur de l’empire. Il faut se coordonner, s’organiser à l’intérieur de l’empire, et mener une lutte comme celle qui s’est déroulée au Vietnam. Le ViêtNam a été gagné, entre autres, parce qu’il existait une organisation politique aux États-Unis qui a mobilisé des millions de personnes dans les rues et a fait en sorte qu’entre la guerre du ViêtNam et la guerre populaire en soutien au ViêtNam, en solidarité avec le Viêt Nam, les troupes états-uniennes ont dû se retirer de ce pays. Les pressions intérieures ont été brutales. Sans cette pression, la guerre aurait probablement duré plus longtemps.
Nous devons réfléchir à un projet anti-impérialiste pour le 21e siècle, un projet qui tienne compte du nombre de Latinos qui sont là et qui ne peuvent être ignorés. Je ne parle pas des Cubains de Miami, mais des travailleurs latinos, des Portoricains, des Mexicains, etc. En outre, il existe toute une littérature anti-impérialiste, anticapitaliste et décolonisatrice aux États-Unis. Cette littérature est inconnue. C’est une littérature très puissante, écrite par de grands penseurs. Elle est inconnue en espagnol, car nombre d’entre eux n’ont pas été traduits. Il existe également une pensée indigène états-unienne. Une pensée puissante, anti-impérialiste, anticapitaliste, décoloniale, mais également inconnue. Il y a beaucoup de choses de ce genre aux États-Unis qui sont peu connues.
José Ernesto Narvaez – Dans le cas du Venezuela et de Porto Rico, existe-t-il des différences dans la projection du colonialisme sur les sujets ?
Porto Rico et le Venezuela partagent l’aspiration à consommer davantage. Bien vivre, c’est consommer plus. Il s’agit d’une idéologie de la consommation, d’une idéologie rentière. Dans le cas du Venezuela, il s’agit du pétrole ; dans le cas de Porto Rico, il s’agit des transferts du gouvernement fédéral américain. C’est une sorte de loyer pour le peuple. Nous avons cela en commun : ce sont des sociétés rentières avec peu de production et de productivité. Bien sûr, la situation et les conditions sont très différentes. Alors que le Venezuela est un pays doté de nombreuses ressources, Porto Rico en a très peu. Le Venezuela est l’un des pays les plus riches du monde et possède son propre État. La révolution bolivarienne a été fondamentale.Dans le cas de Porto Rico, le gouvernement n’a aucune souveraineté, il se trouve dans un état colonial. Il n’y a pas de perspective d’un État indépendant pour le moment. Il n’y a pas d’économie portoricaine, mais une extension de l’économie états-unienne. Le scénario des possibilités est donc totalement différent. Au Venezuela, on peut envisager un projet anti-impérialiste de rupture radicale (regardez les difficultés qu’ils ont rencontrées, mais ils peuvent encore survivre), ce qui n’est pas le cas à Porto Rico. Porto Rico ne peut pas faire cela. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas l’économie politique pour le soutenir. Porto Rico importe 95 % de ce qu’il mange. Toute l’industrie qui existe à Porto Rico est liée, branchée, à l’industrie états-unienne.
À Cuba, de nombreuses choses ont été nationalisées dans les années 1960. Aujourd’hui, à Porto Rico, si vous nationalisez et vous déconnectez du circuit de production industrielle des États-Unis, vous devez fermer, car vous n’avez aucun moyen de tenir. En d’autres termes, tout est bloqué. Les pièces, les matières premières, tout est lié à l’industrie états-unienne. Je nationalise une entreprise pharmaceutique à Porto Rico, par exemple, et je fais une rupture anti-impérialiste, et je la ferme. Ce n’est qu’un maillon de la chaîne. Il existe un autre schéma de production ; un schéma qui a été imposé dans les années 60, 70 et 80 et qui consistait à cesser de produire dans de grandes usines unifiées et à segmenter les chaînes de production. Ce que vous obtenez, c’est un petit maillon. Si vous nationalisez le maillon, on vous a déjà déconnecté.
José Ernesto Narvaez – Existe-t-il une conscience anti-impérialiste parmi les habitants de Porto Rico ?
Les gens ont une conscience culturelle anti-impérialiste, mais pas une conscience politique. À Porto Rico, le nationalisme culturel est impressionnant. Tout le monde s’identifie clairement comme Portoricain et les gens ont un sentiment anti-américain au niveau culturel. Cela ne se traduit pas au niveau politique. D’où la complexité de la situation. Beaucoup de gens sont conscients de ce problème : comment faire la transition entre le Porto Rico d’aujourd’hui et une future société anti-impérialiste. Si cette question n’a pas de réponse claire dans un endroit comme le Venezuela, imaginez à Porto Rico, où il n’y a rien. Rien. Ce qu’il y a, c’est l’économie états-unienne étendue à Porto Rico. Vous voyez ce que je veux dire ?
Beaucoup de gens à Porto Rico pensent des choses comme : « Vous avez mangé la viande, sucez les os ». En d’autres termes, nous allons mener une lutte anti-impérialiste en pénétrant à l’intérieur d’eux. Maintenant que la majorité démographique sera latino, mettons-y un État latino. Et ce sont des annexionnistes anti-impérialistes. Une chose qui ressemble à un court-circuit mental. La première fois que j’ai entendu cela, j’ai failli m’évanouir. Mais en réalité, il y a des gens à Porto Rico qui pensent à ces choses.
J’ai été très impliqué dans la lutte de Vieques[1]. Je me souviens que la plupart des militants de Vieques étaient des annexionnistes. Nous sautions les clôtures des bases militaires, occupions le territoire et paralysions les manœuvres. Ce fut une lutte de plusieurs années. J’ai eu de nombreuses disputes avec mes compatriotes de Vieques, en particulier les pêcheurs, parce que j’étais venu en tant qu’indépendantiste, en tant qu’indépendantiste socialiste, pour soutenir leur lutte. Ils me regardaient et me disaient : « Vous êtes quoi ? un indépendantiste socialiste ? Ah, c’est vrai. Nous sommes des annexionnistes anti-impérialistes ou des antimilitaristes anti-impérialistes« . Ils me disaient des choses comme ça. La plupart des personnes qui se battaient à Vieques pour fermer les bases militaires et les manœuvres militaires étaient des annexionnistes. Comment le formulaient-ils ? Ils disaient : « Si nous étions un État des États-Unis, cela n’arriverait pas« . J’étais choqué. « Si nous étions un État, ce serait encore pire« , disais-je. « Non, parce qu’aux États-Unis, l’obstruction existe » [2], me répondaient-ils. Je parle de gens qui n’ont pas d’éducation universitaire ou quoi que ce soit d’autre, et moi qui avais une éducation universitaire, je ne savais pas de quoi ils parlaient. « Je leur demandais : « Qu’est-ce que c’est que l’obstruction parlementaire ? » « Un sénateur peut se lever et parler et paralyser le Congrès états-unien. Et avec ça, parce que c’est évident et que c’est comme ça, ils doivent s’asseoir et négocier« , ont-ils dit. Je n’ai pas compris de quoi ils parlaient jusqu’à ce que je voie les sénateurs d’Hawaï, deux Asiatiques, qui ont fait cela au Congrès états-unien pour menacer de le paralyser. Ils ont dû s’asseoir et négocier avec eux, parce qu’ils voulaient fermer les bases militaires sur les îles. Et ils les ont fermées. Lorsque cela s’est produit, je me suis souvenu de ce que ces camarades disaient.
Ils m’ont expliqué : « Nous allons nous battre. Nous allons nous adresser à la Cour fédérale états-unienne. Et nous disons ceci : Si vous ne bombardez pas les Blancs en Virginie, vous ne pouvez pas bombarder les Noirs à Vieques, parce que nous sommes des citoyens au même titre qu’eux. Ils sont donc partis avec leurs avocats là-bas, tandis qu’ici, ils ont rendu les bases militaires inopérantes grâce à la désobéissance civile. Et beaucoup de prisonniers. Ils vous ont pris en prison et vous ont mis à Atlanta pendant deux ans, ils vous ont emmené hors du pays dans les prisons fédérales là-bas. Mais la désobéissance civile s’est poursuivie, elle est devenue systématique, si bien qu’ils n’ont pas pu utiliser les bases militaires. Et ils ont dû les fermer en 2003. Entre la lutte au tribunal et la lutte dans les rues, ils les ont fermées en 2003.
La situation à Porto Rico est très complexe. Il est difficile de l’expliquer en dehors de Porto Rico. La lutte anti-impérialiste pour la décolonisation passe par des registres qui ne sont pas encore vus ou compris en Amérique latine. Par exemple, de nombreuses personnes se rendent à Porto Rico et ne comprennent pas pourquoi la majorité des gens votent pour l’annexion et non pour l’indépendance. Que vous disent les gens lorsque vous travaillez avec eux dans la rue ? Que l’indépendance que nous allons avoir sera néocoloniale. Une indépendance où les gringos nous exploiteront comme ils le font en République dominicaine, en Haïti, en Jamaïque et dans les îles voisines. Parce qu’à Porto Rico, l’économie n’est pas assez bonne pour faire autre chose. Vous allez dépendre de l’empire. Vous ne pourrez rien faire d’autre que d’être subordonnés et de ne pas bénéficier des avantages de la colonie. C’est ainsi que les gens vous parlent.
Le calcul qu’ils font est que nous avons plus de chances de mener une lutte anti-impérialiste en allant à l’intérieur et en nous y battant en alliance avec les autres peuples, dans une lutte anti-impérialiste où nous finissons par devenir une néo-colonie. C’est pourquoi, aux États-Unis, les élites impérialistes ne veulent pas de l’annexion de Porto Rico. Chaque fois qu’un référendum est organisé, elles l’annulent, parce que dans les enquêtes, dans les sondages, l’annexion semble l’emporter. Les Blancs, les élites blanches, ne veulent pas de nous, parce que nous ne sommes pas des Américains blancs ; parce que cela va leur coûter cher d’avoir un pays qu’ils ont détruit. Je ne sais pas combien de milliards de dollars nous ne recevons pas aujourd’hui parce que nous ne sommes pas un État des États-Unis. Si l’annexion devait se produire, ils devraient dépenser plus pour Porto Rico, plus qu’ils ne le font aujourd’hui. C’est pourquoi, à chaque fois qu’un référendum sur la création d’un État se présente, en 1991, en 1998, en 2012 et aujourd’hui, ils l’annulent.
En revanche, si Porto Rico votait pour l’indépendance ce soir, ils la lui accorderaient demain. Ils la leur donnent ce soir, pas demain, ils n’attendent pas demain. Parce que c’est la colonie sans les coûts de la colonie. C’est du néocolonialisme. Très peu de gens à Porto Rico votent pour cela. C’est le grand test que nous, les indépendantistes portoricains, avons à faire. Je vous parle de cette façon, un peu comme l’avocat du diable, pour que vous compreniez comment les gens pensent.
Les gens pensent que si vous rendez Porto Rico indépendant, vous allez exproprier les Portoricains de tout, et nous allons devenir une main-d’œuvre bon marché pour les industries américaines sous un régime d’indépendance néo-coloniale. C’est ce qui ressort du programme du parti de l’indépendance portoricaine. En d’autres termes, les soupçons des gens ne sont pas si exagérés. Cette explication, je suis sûr que vous ne l’avez jamais entendue de votre vie, parce qu’il faut être sur place et parler aux gens.
Notes :
[1] Vieques est une île située au sud-est de la grande île de Porto Rico. Entre 1941 et 1948, la marine états-unienne a procédé à une série d’expropriations forcées et à la concentration des habitants dans le centre urbain. En conséquence, 66 % de Vieques sont devenus une zone restreinte sous le contrôle de la marine. La résistance populaire a finalement conduit George W. Bush, en 2003, à ordonner à la marine de quitter la municipalité de l’île.
[2] Terme désignant une pratique d’obstructionnisme parlementaire très répandue aux États-Unis.
Interview réalisée par José Ernesto Narvaez pour La Jiribilla : http://www.lajiribilla.cu/colaborador/jose-ernesto-novaez-guerrero/
Traduction de l’espagnol : Thierry Deronne
URL de cet article : https://venezuelainfos.wordpress.com/2023/05/22/on-ne-peut-etre-decolonial-sans-etre-anti-imperialiste-ramon-grosfoguel/






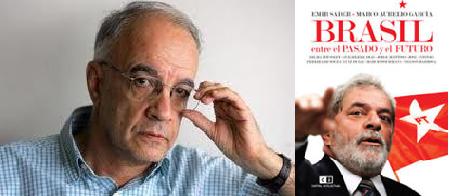

 On ne peut discuter ces réussites mais le problème en soi créé par la maladie de Chávez pointe une caractéristique du processus qui peut être à la fois sa force majeure et sa plus grande faiblesse. Il s’agit en effet de la relation très étroite du processus avec la personne de Chávez, qui s’exprime dans des slogans tels que « Chávez est le peuple”, « Chávez, coeur du peuple » ou « Nous sommes tous Chávez ». En marge de la relation affective que peuvent éprouver d’amples secteurs de la population vénézuélienne pour le dirigeant de la révolution bolivarienne, il est inévitable de lire cette relation imaginaire dans le cadre de la tradition politique de la souveraineté.Dans cette tradition, dont le penseur classique est Thomas Hobbes, le souverain est celui qui unifie le peuple. Il l’unifie dans la mesure où il le représente et il le représente en tant que les individus qui composent la multitude faite peuple, renoncent par contrat à tout droit en propre en faveur du droit absolu du souverain. Pour Hobbes, telle est l’unique manière de surmonter les dangers mortels que suppose la guerre de tous contre tous qui caractérise l’état de nature. De cette façon, le peuple et chacun des individus qui le composent agissent par le biais de leur représentant, à travers le souverain; et par conséquent chaque sujet doit considérer l’action du souverain comme la sienne, en propre. D’un point de vue graphique, Hobbes représentait en couverture de son
On ne peut discuter ces réussites mais le problème en soi créé par la maladie de Chávez pointe une caractéristique du processus qui peut être à la fois sa force majeure et sa plus grande faiblesse. Il s’agit en effet de la relation très étroite du processus avec la personne de Chávez, qui s’exprime dans des slogans tels que « Chávez est le peuple”, « Chávez, coeur du peuple » ou « Nous sommes tous Chávez ». En marge de la relation affective que peuvent éprouver d’amples secteurs de la population vénézuélienne pour le dirigeant de la révolution bolivarienne, il est inévitable de lire cette relation imaginaire dans le cadre de la tradition politique de la souveraineté.Dans cette tradition, dont le penseur classique est Thomas Hobbes, le souverain est celui qui unifie le peuple. Il l’unifie dans la mesure où il le représente et il le représente en tant que les individus qui composent la multitude faite peuple, renoncent par contrat à tout droit en propre en faveur du droit absolu du souverain. Pour Hobbes, telle est l’unique manière de surmonter les dangers mortels que suppose la guerre de tous contre tous qui caractérise l’état de nature. De cette façon, le peuple et chacun des individus qui le composent agissent par le biais de leur représentant, à travers le souverain; et par conséquent chaque sujet doit considérer l’action du souverain comme la sienne, en propre. D’un point de vue graphique, Hobbes représentait en couverture de son 



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.