Au début du mois de mars 2024, devant les chefs d’État de la CELAC réunis à Kingstown (Saint-Vincent-et-les-Grenadines), le président vénézuélien Nicolás Maduro a dénoncé les nouvelles menaces qui pèsent sur le peuple haïtien : « Nous ne sommes pas d’accord avec une invasion, qu’elle soit ouverte ou camouflée. La solution, c’est que l’Amérique latine et les Caraïbes accompagnent, aident Haïti à suivre sa propre voie et à mettre en œuvre son propre modèle, à reconstruire son propre État, ses propres institutions, et renouer avec toutes les formes de coopération comme le programme de pétrole à bas prix PetroCaribe lancé par Chávez. ». Trois jours plus tard, à Caracas, il a poursuivi : « Combien d’interventions militaires les États-Unis ont-ils menées en Haïti ? Lorsque la renaissance du peuple haïtien s’est produite au début de ce siècle, nous nous sommes réveillés avec la nouvelle qu’un avion états-unien avait emmené, après l’avoir kidnappé, le président Aristide hors de son pays. Haïti a été démembré, martyrisé par l’interventionnisme impérialiste, ils l’ont détruit de l’intérieur. On parle aujourd’hui d’un soulèvement de gangs criminels. Mais qui les a dotés de tous ces fusils ? Ces armes sont venues massivement des États-Unis. À qui profite le chaos ? Qui veut une invasion ? Ce qui se passe en Haïti, ils l’ont tenté ici au Venezuela lors des déstabilisations de l’extrême droite, et veulent le refaire ici en cette année électorale… Le narco-chaos est une nouvelle forme de domination. »
« Guerre de gangs, spirale de la violence »… Le « présentisme » des médias sert à cacher l’intervention états-unienne contre Haïti. Nous publions ci-dessous l’analyse de la professeure haïtienne d’anthropologie Jemima Pierre qui dévoile le « laboratoire impérialiste » dénoncé par Cuba et par le Venezuela.
Si votre connaissance d’Haïti provient uniquement des médias occidentaux, vous pourriez être pardonné de croire aux affirmations suivantes :
« Haïti, un « État en faillite » envahi par la « violence des gangs », ne peut retrouver sa stabilité que par l’invasion d’une force militaire étrangère. »
« Haïti a un gouvernement souverain qui a l’autorité légale de demander une invasion militaire du pays pour « combattre les gangs. »
« Les États-Unis, en poussant le Kenya et les pays du CARICOM à mener une invasion armée étrangère en Haïti, agissent avec les meilleures intentions en Haïti et s’engagent à garantir la paix et la stabilité en Haïti et dans la région des Caraïbes. »
« La CARICOM agit en solidarité avec le peuple haïtien et soutient la souveraineté haïtienne. »
Aucune de ces déclarations n’est vraie. En fait, elles contribuent à obscurcir non seulement les motivations qui sous-tendent les récents appels à une intervention étrangère en Haïti, mais aussi la nature de la réalité politico-économique actuelle d’Haïti et l’histoire qui a permis à ce pays d’en arriver là. La répétition et la saturation de ces affirmations dans les médias, même dans la région des Caraïbes, a dupé une grande partie du monde en l’amenant à applaudir une intervention militaire étrangère en Haïti. La vérité est que, sous couvert d’aider Haïti, la souveraineté et l’indépendance de ce pays sont en fait en train d’être étouffées.
Que se passe-t-il donc en Haïti ? Pourquoi les États-Unis font-ils pression pour une nouvelle invasion militaire étrangère en Haïti ? Pourquoi les pays du CARICOM leur apportent-ils leur aide ? Plus important encore, pourquoi les États-Unis accordent-ils autant d’attention à la situation en Haïti ?
Comprendre ce qui se passe en Haïti, c’est comprendre à quel point l’agression impériale, occidentale, contre le peuple haïtien et la souveraineté haïtienne a été et reste constante. Cette agression se traduit par le fait qu’Haïti est actuellement sous occupation étrangère, et ce depuis vingt ans. Il ne s’agit pas d’une exagération. La seule solution à la crise actuelle en Haïti est la fin de l’occupation étrangère actuelle.
En 2004, Haïti a célébré le bicentenaire de son indépendance. La même année, l’indépendance d’Haïti a été contrecarrée par des puissances étrangères. Un an plus tôt, la France, le Canada et les États-Unis ont ourdi un complot lors des réunions de l' »Initiative d’Ottawa sur Haïti » pour renverser le gouvernement élu d’Haïti. Au petit matin du 29 février 2004, le complot s’est déroulé. Ce matin-là, le président Jean-Bertrand Aristide a été enlevé par des marines états-uniens et envoyé sur une base militaire en République centrafricaine. Ce jour-là, George W. Bush a annoncé qu’il envoyait des forces militaires en Haïti pour « aider à stabiliser le pays » et, dans la soirée, deux mille soldats états-uniens, français et canadiens étaient sur le terrain. La CARICOM, sous la direction du premier ministre jamaïcain P. J. Patterson, protesta vigoureusement contre le coup d’État.
La force d’invasion franco-américano-canadienne a ciblé et tué les partisans d’Aristide, a supervisé l’installation d’un premier ministre fantoche et a permis la formation d’une force paramilitaire qui a mis en place des escadrons de la mort anti-Aristide. Le coup d’État a ensuite été blanchi par les Nations Unies qui, sous la direction des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, les États-Unis et la France, ont voté l’envoi d’une mission de « maintien de la paix » en Haïti. La mission a été déployée dans le cadre d’un mandat « chapitre 7 » permettant aux soldats étrangers d’utiliser toute la force contre la population.L’ONU a pris le relais des forces états-uniennes et a créé la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), chargée de l’occupation militaire sous le couvert de « l’instauration de la paix et de la sécurité. »
Opération de plusieurs milliards de dollars, la MINUSTAH comptait, à tout moment, entre 6.000 et 12.000 militaires et policiers stationnés en Haïti, ainsi que des milliers de civils. L’aile militaire de la mission MINUSTAH était dirigée par le Brésil, qui fournissait la plus grande partie des soldats.Toutefois, cette force d’occupation militaire multinationale comprenait également des soldats de plusieurs pays des Caraïbes, d’Amérique du Sud et d’Afrique, dont l’Argentine, le Chili, la Colombie, la Jamaïque, la Grenade, le Bénin, le Burkina Faso, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, le Niger et le Mali.
L’occupation de l’ONU sous la MINUSTAH a été marquée par sa brutalité à l’égard du peuple haïtien. Des civils ont été attaqués et assassinés. Des « soldats de la paix » ont commis des crimes sexuels.Les soldats de l’ONU ont déversé des déchets humains dans les rivières utilisées pour l’eau potable, déclenchant une épidémie de choléra qui a tué entre 10 000 et 40 000 personnes. L’ONU n’a jamais été tenue responsable de ces crimes contre le peuple haïtien.
L’occupation a été renforcée par la création et l’opérationnalisation du Core Group. Le Core Group est un groupe non élu d’étrangers originaires du Brésil, du Canada, de France, d’Espagne, des États-Unis et d’Allemagne qui s’est autoproclamé arbitre de la politique haïtienne. Ni neutre ni passif, le Core Group joue un rôle actif et interventionniste dans les affaires politiques quotidiennes d’Haïti. Il s’est efforcé d’étendre et de protéger les intérêts économiques étrangers en Haïti. Il n’a cessé d’intervenir dans les affaires politiques souveraines d’Haïti, souvent sans la collaboration ou le consentement du gouvernement haïtien.
On prétend que cette occupation a officiellement pris fin en 2017 avec le retrait officiel de la mission MINUSTAH. Pourtant, l’ONU est restée en Haïti par l’intermédiaire d’un nouveau bureau avec un nouvel acronyme : BINUH, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Haïti est actuellement dirigé par un groupe d’étrangers non haïtiens, le Core Group et le bureau BINUH, ceux-là mêmes qui sont responsables de la destruction de sa démocratie.
L’occupation du Core Group est à l’origine de la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement le pays. Les forces d’occupation ont supervisé l’effondrement complet de l’État haïtien tout en permettant à un groupe d’étrangers malhonnêtes – pays et entreprises, organisations non gouvernementales et multinationales – de reprendre les fragments brisés de l’économie politique haïtienne, en grande partie pour servir des intérêts étrangers. En fait, c’est sous cette occupation que les États-Unis et leurs alliés, la France et le Canada, ont installé le néo-duvaliériste Michel Martelly en 2011, au lendemain du tremblement de terre de 2010 ; le successeur de Martelly, Jovenel Moïse, en 2016 ; et l’actuel Premier ministre de facto non élu, Ariel Henry, après l’assassinat de Moïse en 2021.
Sous l’occupation du Core Group, la vie de l’Haïtien moyen s’est détériorée. Mais il faut aussi être clair : le peuple haïtien n’a pas pris l’occupation à la légère (1). L’un des aspects les moins médiatisés de la « crise » actuelle en Haïti est la protestation continue du peuple haïtien contre l’occupation et pour l’autodétermination. Le peuple a manifesté par centaines de milliers en 2004 après la destitution d’Aristide par les États-Unis, la France et le Canada. Il a protesté contre l’imposition d’un autre président illégitime, Jovenel Moïse, en 2015 et 2016. Ils ont protesté contre la corruption du parti politique de Martelly et Moïse, le PHTK, imposé par les États-Unis, en 2018 et 2019. Et ils ont protesté contre le premier ministre non élu et installé de facto par les États-Unis, Ariel Henry.
Depuis plus de deux ans maintenant, les États-Unis font pression pour un renforcement de la présence militaire en Haïti et ont protégé le gouvernement fantoche d’Ariel Henry, non élu et impopulaire, jusqu’à sa démission récente. Ils ont protégé ce gouvernement afin de continuer à contrôler Haïti. En fait, les gouvernements fantoches d’Haïti ont bien servi les États-Unis. Par exemple, c’est Ariel Henry qui a imposé la suppression des subventions au carburant pour la population, soutenue par le FMI, que les États-Unis préconisent depuis des années et qui a plongé le peuple haïtien dans une pauvreté encore plus grande.
Aujourd’hui, les États-Unis ont besoin de maintenir leur contrôle sur Haïti car le pays est stratégiquement important pour leurs objectifs géopolitiques – la poursuite de la militarisation de la région des Caraïbes et de l’Amérique latine en préparation de leur confrontation avec la Chine et la mise en œuvre de la loi sur les fragilités globales (Global Fragilities Act). Pourtant, les États-Unis ne sont pas disposés à poser leurs propres bottes sur le terrain, et se tournent d’abord vers le Canada, puis vers le Brésil, puis vers les pays de la CELAC et de la CARICOM, tous réticents à mener la mission, même s’ils ont soutenu l’appel à l’intervention militaire. Le gouvernement kenyan de William Ruto a sauté sur l’occasion de mener l’intervention, acheté par un sac d’argent et une tape d’approbation sur leur tête néolibérale. Haïti va maintenant être envahi par les États-Unis, mais avec la « face noire » du Kenya et des pays de la CARICOM comme couverture.
Les citoyens du Kenya et des pays du CARICOM ont-ils demandé à leurs gouvernements pourquoi les États-Unis, le Canada ou la France n’enverraient pas leurs propres soldats pour envahir et occuper Haïti cette fois-ci ? Les citoyens de ces pays ont-ils considéré que le « Premier ministre » de facto non élu, Ariel Henry (aujourd’hui démissionnaire, NdT), n’a aucune base légale pour appeler à une invasion étrangère d’Haïti ? Les citoyens de ces pays se sont-ils demandé se sont-ils demandé pourquoi les États-Unis ou l’ONU n’appellent pas à l’invasion armée d’un pays comme l’Équateur, où des gangs brutaux ont assiégé le pays, ou la Jamaïque, où l’état d’urgence est quasi permanent, ou les États-Unis eux-mêmes, où des fusillades de masse sont perpétrées chaque jour ? Les citoyens de ces pays se sont-ils demandé pourquoi les États-Unis ou les Nations unies n’appellent pas à l’invasion armée d’Israël, qui commet un génocide ?
Pourquoi Haïti ?
On nous dit que l’intérêt des États-Unis pour Haïti est humanitaire, que les États-Unis veulent protéger le peuple haïtien des « gangs criminels ». Pourtant, les armes états-uniennes ont inondé Haïti et les États-Unis ont constamment rejeté les appels à l’application effective de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU pour un embargo sur les armes contre les élites haïtiennes et états-uniennes qui importent des armes dans le pays. En outre, lorsque nous parlons de « gangs », nous devons reconnaître que les gangs les plus puissants du pays sont des filiales des États-Unis eux-mêmes : le Bureau intégré des Nations unies (BINUH) et le Core Group, les deux entités coloniales qui ont effectivement dirigé le pays depuis le coup d’État de 2004. C’est ce gang, le Core Group et son Premier ministre installé, Henry, qui, avec le bureau de l’ONU en Haïti, insiste sur cette solution violente à la crise dans le pays – une crise qu’ils ont eux-mêmes contribué à créer.
Alors qu’Haïti est confronté à une nouvelle invasion – cette fois-ci menée nominalement par le Kenya et les pays du CARICOM – je voudrais demander à la communauté caribéenne de réfléchir au vaste arsenal dont dispose l’empire états-unien pour convaincre le reste du monde d’accepter volontiers une nouvelle attaque contre la souveraineté haïtienne. Je voudrais également demander à la communauté caribéenne de prendre en considération le fait qu’une grande partie de ce que nous entendons sur Haïti aujourd’hui est une déformation – ou une fabrication pure et simple – de la réalité sociale et politique d’Haïti.
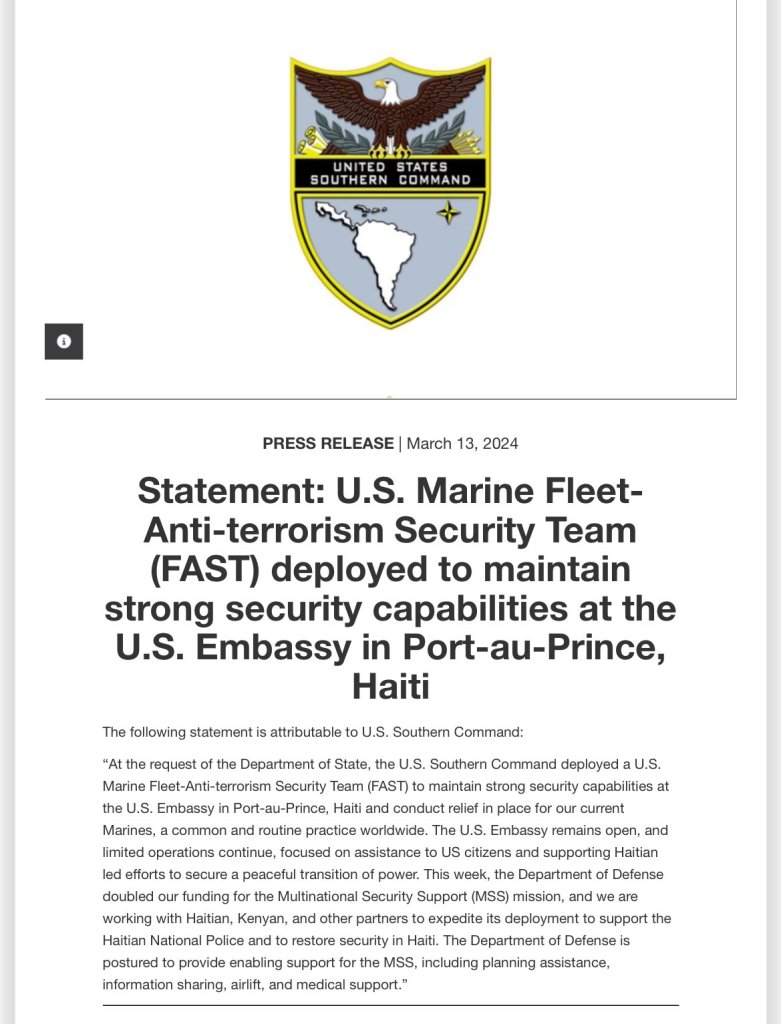
La plupart d’entre eux manquent de contexte historique, en particulier lorsqu’il s’agit de l’ingérence incessante des agents et institutions étrangers, pour comprendre la situation haïtienne. Elle repose en grande partie sur un racisme profond qui présume que les Noirs sont ingouvernables tout en s’opposant aux implications de l’engagement historique d’Haïti en faveur de la liberté des Noirs.
Dans le même temps, les protestations continues de la communauté haïtienne contre les troupes étrangères et l’ingérence occidentale témoignent de son courage inébranlable. Haïti est le théâtre de l’une des plus longues luttes au monde pour la libération des Noirs et l’indépendance anticoloniale. Cela explique l’assaut réactionnaire constant de l’empire états-unien contre le peuple haïtien, punissant ses tentatives répétées de souveraineté par des décennies d’instabilité destinées à garantir et à étendre l’hégémonie des Etats-Unis. Depuis deux siècles, la contre-insurrection impériale contre Haïti vise à mettre fin à l’expérience révolutionnaire la plus ambitieuse du monde moderne. Les tactiques déployées pour attaquer la souveraineté haïtienne ont été cohérentes et persistantes.
Alors que Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, était au Guyana le week-end dernier, en partie pour « continuer à rallier le soutien mondial à la mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) en Haïti », nous devons nous demander pourquoi les dirigeants de la CARICOM veulent participer à la destruction de la souveraineté et du peuple haïtiens. Et nous devons nous rappeler que la « crise » en Haïti a été créée et entretenue par les États-Unis et leurs alliés. Les pays de la CARICOM doivent s’opposer à l’occupation étrangère d’Haïti et ne pas prolonger la crise.
Après la démission d’Ariel Henry, les États-Unis sont en train de créer le nouveau « gouvernement » d’Haïti en donnant à leurs protégés de la bourgeoisie haïtienne de 24 à48 heures pour envoyer des noms à un « conseil présidentiel » dont la première priorité est de préparer le pays à une intervention armée étrangère.
Tout Haïtien participant à cette mascarade est un traître.
Jemima Pierre
L’auteure : D’origine haïtienne, Jemima Pierre est professeure d’anthropologie à l’UCLA, à l’Institut de justice sociale de l’université de Colombie-Britannique et associée de recherche au Centre d’étude de la race, du genre et de la classe sociale de l’université de Johannesburg. Coordinatrice pour Haïti/Amériques de l’Alliance Noire pour la Paix (Black Alliance for Peace)
Note:
Traduction de l’anglais : Thierry Deronne
URL de cet article : https://venezuelainfos.wordpress.com/2024/03/13/jemima-pierre-loccident-a-encore-peur-des-noirs-dhaiti-a-propos-du-laboratoire-imperialiste-denonce-par-le-venezuela/


















 Les accords d’intégration déterminent l’influence géopolitique d’un pays. La coopération internationale s’avère un élément indispensable au développement socioéconomique et au bien-être des populations.
Les accords d’intégration déterminent l’influence géopolitique d’un pays. La coopération internationale s’avère un élément indispensable au développement socioéconomique et au bien-être des populations.




 La vie en Haïti, qui était déjà extrêmement difficile, devint alors intenable. Maintenant que le robinet de brut vénézuélien était fermé, le Fonds Monétaire International (FMI) – préposé aux sales besognes de Washington – a indiqué à Jovenel qu’il devait augmenter le prix du gaz, ce qu’il tenta de faire le 6 juillet 2018. Le résultat fut une explosion populaire qui dura 3 jours et annonçait la révolte d’aujourd’hui.
La vie en Haïti, qui était déjà extrêmement difficile, devint alors intenable. Maintenant que le robinet de brut vénézuélien était fermé, le Fonds Monétaire International (FMI) – préposé aux sales besognes de Washington – a indiqué à Jovenel qu’il devait augmenter le prix du gaz, ce qu’il tenta de faire le 6 juillet 2018. Le résultat fut une explosion populaire qui dura 3 jours et annonçait la révolte d’aujourd’hui.
 « Séchons avec le feu sacré de notre conscience, séchons les larmes de l’Afrique, mais également celles de l’Amérique latine, pour que… les pleurs de nos siècles se
« Séchons avec le feu sacré de notre conscience, séchons les larmes de l’Afrique, mais également celles de l’Amérique latine, pour que… les pleurs de nos siècles se





















Vous devez être connecté pour poster un commentaire.