Interrompre une vie asservie – libérer l’âme d’un enfant : les récits d’insurrection dans les arts sur l’utilisation politique du corps chez les femmes asservies (1).
Meyby Soraya Ugueto-Ponce (2)
Institut Vénézuélien de Recherche Scientifique / Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora, Venezuela
meybyugueto@yahoo.es
Malgré la violence et l’excision du corps des femmes africaines et afro-descendantes pendant le développement du régime esclavagiste, celles-ci ont pris des décisions face aux contrôles nécropolitiques de l’époque. Dans cet essai, j’analyse l’interruption de grossesse des femmes asservies comme une résistance au développement matériel de l’esclavage, c’est-à-dire l’utilisation politique du corps pour éviter de reproduire le travail servile, interrompre la vie potentielle asservie et libérer l’âme d’un enfant. À travers l’analyse des œuvres de l’artiste visuelle Joscelyn Gardner et des passages de la littérature autobiographique afro-caribéenne de Maryse Condé, je réfléchis à la construction d’un récit insurgé qui s’appuie sur l’action de ces femmes pendant l’esclavage. Dans une perspective décoloniale, afro-féministe et antiraciste, j’adopte une approche méthodologique centrée sur l’art comme moyen de réflexion-transformation du passé colonial. Ensuite je raconte le processus de création de la pièce dansée Memorias danzadas – encore en construction – afin de proposer un récit insurgé à travers le mouvement. Je conclus qu’il est nécessaire de problématiser l’imaginaire de la passivité et de la soumission qui a prédominé à propos de l’esclavage domestique, de le problématiser en construisant des récits à partir de l’art afin d’enrichir les profils des identités politiques sur le rôle joué par les femmes noires dans leur vie et celle de leurs proches, et face au système esclavagiste. Insurgence par l’art contre le racisme structurel avec de nouveaux, nouveaux avec des référents nouveaux, critiques et propres.
Introduction
Il ne semblait pas y avoir de place pour plus de douleur. Ce que l’historien a décrit alors qu’il menait le groupe à travers les sombres et denses donjons du château-prison était infâme. Rien ne pouvait surpasser le fait qu’ils avaient été condamnés à la maltraitance, à l’enfermement et à la surpopulation, sans avoir été coupables de quoi que ce soit. De plus, en écoutant et en regardant, je me suis dit qu’il n’y avait rien de pire que d’être séparé de sa famille, de sa terre, de ses rêves, bref, de sa vie. Mais il n’en était pas ainsi : il suffisait d’arriver au centre de l’enceinte, il suffisait d’être là pour imaginer, après l’écoute attentive du guide local, comment le gouverneur, de sa chambre à l’étage, a choisi l’africaine qui allait satisfaire ses désirs lubriques. Avec une modulation et une sérénité parfaites, mais sans dédain, le ghanéen engagé a décrit comment les corps des femmes asservies étaient battus, toilettés, conduits, utilisés, fécondés, jetés et même tués.
J’ai réussi à écrire ces mots quelques mois après mon arrivée du Ghana, en Afrique, après avoir visité le château d’Elmina en septembre 2018, avec un groupe d’ibéro-américains, dans le cadre d’une rencontre de mouvements sociaux, d’organisations et de partis politiques du monde entier réunis à Winneba, Accra, au Ghana pour la troisième conférence sur le panafricanisme.
C’est la femme qui a murmuré ou crié : « (Mange la terre, n’ayez pas d’enfants pour l’esclavage) ; la terre pour être stérile ; la terre pour mourir ». Ainsi, parfois, ce fut la femme qui refusa de porter dans son ventre le bénéfice du maître. L’histoire de l’institution familiale en Martinique est sous-tendue par ce refus. C’est l’histoire d’un énorme avortement primordial ; le mot qui reste dans la gorge avec le premier cri (Glissant, 2005, p. 130).
Le philosophe, poète et essayiste martiniquais Édouard Glissant expose les implications psychosociales et anthropologiques des décisions forcées que certaines femmes africaines et leurs descendantes ont prises sur leur corps pour tenter de modifier, à la plus petite échelle, la traite des esclaves et l’avancée matérielle du capitalisme. « C’est l’histoire d’un immense avortement primordial« , dit-il de la famille antillaise et, par extension, de la famille afrodiasporique. Une empreinte émotionnelle évidente qui a joué un rôle dans la reconstruction de nos sociétés depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui.
En transcrivant le récit par lequel j’ouvre cet essai, profondément émue par ce que j’ai vécu, je me souviens de ce qui a pu être le produit d’un jeu entre faits et fiction, qu’il ait été construit par moi ou par l’historien ghanéen Ato Ashun alors qu’il nous guidait dans notre voyage : « Ce moment avant que nous arrivions à la porte du non-retour était le dernier moment où beaucoup d’entre eux revoyaient leurs femmes ou leurs maris, leurs fils ou leurs filles, après des mois d’emprisonnement. » Il faisait référence à la salle qui avait été spectatrice d’une douleur profonde et qui, des siècles plus tard, était le témoin de nouveaux cris et hurlements impossibles à contenir devant cette porte déshumanisante qui se trouvait devant les yeux de ceux d’entre nous qui la visitaient. J’ai succombé, mais, après avoir calmé une douleur exprimée en larmes, et qui n’était pas seulement la mienne, j’ai terminé en disant :
La porte de non-retour est un mensonge ; nous sommes ici aujourd’hui pour que nos ancêtres retournent en Afrique à travers nous, mais surtout pour guérir les blessures que ce terrible moment de l’histoire a laissées à l’Humanité.
L’étude des politiques de faire-mourir-et-laisser-vivre appliquées aux femmes pendant l’esclavage et les stratégies utilisées par les femmes pour résister à ces nécrocontrôles, ou pour les prendre sur elles-mêmes après avoir pris conscience de cette logique de mort, est une tâche nécessaire pour la reconstruction de l’histoire des femmes noires dans les Amériques. La littérature transatlantique axée sur le genre et consacrée à la compréhension de la vie sociale des femmes d’ascendance africaine, la maternité, les soins, l’allaitement et le travail, s’y intéresse depuis les années 1980, avec beaucoup moins de représentants en Amérique latine (Féres da Silva Telles, 2018). Dans le cas du Venezuela, l’étude des femmes a également suivi cette voie. Cette dette a commencé à être comblée il y a près de deux décennies, alors que les premières recherches, surtout historiques, sur les femmes en général et les femmes asservies en particulier avaient déjà été menées (Dávila Mendoza, 2009 ; Díaz, 2004 ; Laurent-Pe rrault, 2012, 2015, 2018 ; Quintero, 2008 ; Rojas, 2014 ; Taylor, 2011 ; Zambrano, 2014). L’historienne vénézuélienne Inés Quintero nous encourage :
les possibilités qu’offrent l’exploration et l’analyse des témoignages, des plaintes, des réclamations, des expériences et des opinions des esclaves comme moyen de pénétrer dans l’horreur et la violence du régime esclavagiste au Venezuela et aussi comme moyen de connaître les contradictions, les conflits et les problèmes que les esclaves ont rencontrés en tant que femmes lorsqu’elles ont essayé d’obtenir leur liberté, en tant que mères, en tant qu’esclaves ou en tant que concubines de leurs maîtres, et aussi comme moyen de connaître les contradictions, les conflits et les problèmes que les esclaves ont rencontrés lorsqu’elles ont essayé d’obtenir leur liberté, en tant que mères, en tant qu’esclaves ou en tant que concubines de leurs maîtres. comme mères, comme esclaves, ou comme concubines de leurs maîtres. (c’est nous qui soulignons) (2008, p. 79).
Par conséquent, l’objectif de cet essai est de réfléchir aux décisions que certaines femmes africaines et afrodescendantes ont prises au sujet de leur corps, de leur vie et de leurs futurs fils et filles pendant l’esclavage, pas seulement d’un point de vue historique mais aussi à partir de l’analyse des arts en tant que puissant dispositif permettant d’approcher, de traduire et de transformer l’interprétation que nous avons de la société coloniale et des imaginaires qui ont été érigés jusqu’à présent à son sujet et aux sujets qui l’ont façonnée.
Je le ferai à travers une méthodologie qui reprend des éléments de l’auto-ethnographie de l’auteur elle-même, mais aussi des œuvres plastiques et littéraires de Joscelyn Gardner et Maryse Condé. Enfin, je réfléchirai à un processus de création autour de la danse du groupe Trama-Danza, que je dirige. L’objectif n’est pas seulement de proposer une approche méthodologique axée sur l’interprétation de l’art réalisé à partir d’une prise de conscience des oppressions de genre, de race et de classe comme moyen de réflexion-transformation de notre vision de la Colonie, mais aussi comme moyen de guérison des blessures transgénérationnelles qui survivent encore dans nos sociétés. Surtout, l’objectif est d’insurger avec des récits qui remettent en cause les imaginaires préjugés existants sur l’esclavage féminin, en se basant sur la traduction de celui-ci par des artistes visuels, des écrivains et des danseurs.
L’utilisation politique du corps des femmes dans des conditions d’asservissement : l’avortement comme stratégie de résistance au système esclavagiste.
Il existe des études qui démontrent diverses réponses de résistance de la part des hommes et des femmes pendant l’esclavage, comme, par exemple, les suicides, les infanticides, les grèves assises, le marronnage, les rébellions et la fondation de villes noires libres (Moscoso, 1995). La participation des Africains et des Afro-descendants à ce qu’on appelait « métiers bas et serviles » (Brito Figueroa, 1990, p. 276) a été considéré au cours des dernières décennies comme moyen de contourner les assauts de l’esclavage dans une perspective non violente. D’autre part, dans la condition d’esclavage domestique, il y avait la possibilité de construire un réseau de contacts et d’informations en raison des relations sociales, commerciales, religieuses, politiques et militaires auxquelles on avait accès à partir de cette condition, différente de celle des autres Africains ou de leurs descendants aux Amériques en situation de rupture, de rébellion ou de négociation avec le système (Ugueto-Ponce, 2015).
Dans le cas particulier de l’esclavage féminin, des études ont été menées pour détailler les différentes stratégies exercées par les femmes asservies pour éviter les rigueurs du système, pour rendre leur vie, celle de leurs maris et celle de leurs fils et filles plus supportables, et, bien sûr, pour obtenir la liberté (Arrelucea, 2007 ; Dávila Mendoza, 2009 ; Laurent-Perrault, 2015 ; Quintero, 2008 ; Vergara Figueroa et Cosme Puntiel, 2018). Les pétitions pour la liberté et la protection de certains droits devant les autorités civiles et ecclésiastiques ont été l’un des principaux exemples rendus visibles au cours de la dernière décennie, où de grands efforts ont été déployés par les femmes asservies pour présenter, même au mépris de leur propre humanité, des arguments qui leur permettraient d’échapper à l’asservissement ou d’améliorer leurs conditions d’asservissement, ainsi que celles de leur future progéniture. Cette forme de résistance a été désignée de diverses manières, depuis l’idée plus générale de « marronnage légal » (García, 1989, pp. 61-62, 1996, 2005), de « marronnage à court terme » (Laurent-Perrault, 2015) ou de « marronnage légal temporaire » (Laurent-Perrault, 2018, p. 90), ou encore d’attitude « législative féminine » (Arrelucea, 2007) jusqu’aux actions légales menées en défense de leurs « droits personnels » (Dávila Mendoza, 2009).
Mais qu’en est-il de ces pratiques individuelles et non visiblement violentes menées en dehors de la loi ? Comment pouvons-nous interpréter ces pratiques qui ont tenté, à une échelle minimale, d’avoir un impact sur l’avancement matériel du système esclavagiste, sans violer radicalement la structure de l’oppression, en se glissant dans les fissures laissées par le système législatif ? Ces actions confinées à la clandestinité peuvent-elles être comprises dans cette même logique de résistance culturelle ? Je soutiens que oui. Le fait que les femmes africaines et leurs descendants aient pris des décisions sur leur corps, même au risque de la mort, face aux contrôles nécropolitiques qui leur étaient appliqués à l’époque, et par la pratique de l’avortement elle-même, est aussi un exemple des stratégies variées de résistance qui, contrairement aux cas précédents, se sont faites dans la plupart des cas en dehors de la loi ou en profitant des fissures de celle-ci.
Ces mécanismes [l’avortement] faisaient partie des stratégies de résistance des femmes noires asservies, non seulement pour obtenir leur liberté et celle de leurs enfants, mais aussi pour rompre avec les codes juridiques et les dynamiques économiques de la matrice de pouvoir et de domination de la société coloniale et moderne. (Hernández Reyes, 2018, p. 48)
La réflexion sur l’interruption de grossesse dans l’esclavage noir colonial nous rapproche des connaissances qu’elles possédaient sur les processus de la santé et de la maladie, de la vie et de la mort ; des systèmes complets de connaissances, comme la profession de sage-femme et son confinement dans le domaine de l’illégal, de l’ignorance et de la barbarie ; et, en même temps, de la collectivisation de cette pratique parmi les femmes noires :
Les rares mentions dans la littérature coloniale de pratiques abortives sont dues au fait que la connaissance et la manipulation des plantes anti-fertilisantes appartenait à la culture des femmes. Celles qui se distinguaient en tant que guérisseuses n’étaient pas seulement des sages-femmes qui aidaient les autres femmes à mener leur grossesse à terme. Elles étaient des femmes-médecins, des herboristes, des conseillères qui aidaient aussi bien les hommes que les femmes. Elles étaient reconnues par le groupe social auquel elles appartenaient et leur aide était indispensable dans les décisions familiales critiques. Leur sagesse dans la connaissance des plantes avait été acquise au cours de siècles d’observation et d’expérimentation. En outre, l’art de guérir était lié à l’esprit de la maternité, qui combinait idéalement sagesse et soins, tendresse et technique. Les sages-femmes opèrent dans un réseau d’entraide féminine où la présence des hommes n’était pas légitimée (Dueñas, 1996, p. 46).
La littérature historique sur la pratique de l’avortement intentionnel dans la société coloniale de pays comme la Colombie (Dueñas, 1996 ; Gutiérrez Urquijo, 2009 ; Soto Lira, 1992) coïncide dans sa condamnation comme crime suite à des inconsistances dans la définition de la vie humaine puis à des déterminations religieuses dans son applicabilité légale. C’est ainsi qu’elle s’est imposée comme une pratique cachée chez les femmes africaines et leurs descendants, qui évitaient d’être découvertes pour ne pas être punies. La spécificité et la difficulté du sujet ont été réinterprétées dans les récits artistiques. La littérature les ont beaucoup explorées, principalement à partir du courant intra-historique et autobiographique ; les arts plastiques, pour leur part, ont également progressé dans ce domaine. Je considère que, pour le cas vénézuélien, les arts du spectacle pourraient constituer un dispositif communicationnel puissant pour approfondir ces représentations. Je pars des approches de la féministe afro-colombienne Astrid Cuero Montenegro, qui parle, d’une part, de l’expérience de la construction de la connaissance et l’analyse des oppressions depuis les corps qui les vivent et y résistent, comme un défi pour les féminismes noirs ; et, d’autre part, de l’importance de traduire ces expériences dans d’autres langages symboliques, comme l’art dans ses différentes plateformes (Cuero Montenegro, 2017). Je considère qu’il est nécessaire de construire de nouvelles subjectivités parmi les générations actuelles, avec une sensibilité croisée par les débats autour des corps des femmes appauvries et racisées.
Et, pour le cas spécifique de l’avortement, il est important de reconnaître l’existence d’un horizon historique particulier de cette pratique, qui n’est pas centré sur le discours libéral du corps individuel, mais plutôt sur une logique qui découle d’un sentiment profondément collectif, dans lequel le corps et l’avortement comme action politique sont mis au service de tout un groupe culturel et contre un système oppressif non seulement patriarcal, mais racialisé. Ainsi, le corps noir est d’une importance capitale pour la compréhension des processus actuels de lutte contre les différentes formes d’oppression. Nous suivons Csordas lorsqu’il dit que la culture est ancrée dans le corps humain (1994), que le corps humain est un locus important à partir duquel s’opère la reconstruction culturelle (F. Forster, 1994). 1999 ; Halliburton, 2002 ; Lock, 1993), et en supposant qu’une grande partie du support expérientiel des cultures afro-descendantes est liée au corps, car celui-ci était le signe à partir duquel l’être, ou plutôt le non-être, africain était défini (Fanon, 1952/1973), à partir du XVème siècle et par la rationalité moderne/coloniale. La réflexion sur l’usage politique que ces femmes ont fait de leur corps, et leur représentation dans différentes plateformes artistiques, est très intéressante et nécessaire pour contribuer à la construction d’une histoire des femmes au Venezuela, dans la perspective de l’ethnicité, de l’antiracisme et d’une forme de « féminisme noir », ou un ensemble de connaissances contre le patriarcat qui fait encore l’objet d’une réflexion au Venezuela.
Joscelyn Gardner et Maryse Condé : Récits insurgés sur les femmes asservies
Dans la réflexion sur les formes, les structures et les moyens d’expression à travers lesquels les relations entre l’art, la culture et la politique sont possibles, il est nécessaire de souligner la capacité d’énonciation de l’œuvre par rapport au monde qui entoure l’artiste. Il ne s’agit donc pas d’une procédure par laquelle l’œuvre d’art serait le résultat d’un condensé de moyens expressifs qui copierait les problèmes de l’environnement ; Au contraire, il s’agirait de reformuler ou de faire émerger une nouvelle réalité qui confronte le monde social à partir de ses contradictions. En ce sens, la source à partir de laquelle l’acte créatif est possible ne se situe pas seulement dans l’intériorité subjective d’un artiste qui comprend son monde, mais dans la relation sociale, dans l’interaction avec d’autres réalités, dans laquelle émergent de nouvelles manières de comprendre. Le point de départ est la nécessité de comprendre l’art qui naît de l’engagement politique comme le résultat de l’articulation d’imaginaires, de discours et de subjectivités, qui éclatent violemment face aux impositions hégémoniques de sens, en montrant leurs contradictions et en affrontant leurs vides, afin de construire de nouvelles formes de dialogue avec ce qui a été historiquement défini comme les « autres » face aux impositions d’un marché, d’un discours institutionnel et d’un système système qui les rend invisibles.
Ce lieu d’énonciation implique l’œuvre d’art dans les tensions présentes dans les changements sociaux, économiques et politiques en constante évolution et qui nous construisent constamment en tant que société. En ce sens, (1) comment l’art peut-il être un moyen de réflexion-transformation de notre regard sur le passé colonial ; et (2) en quoi l’art peut-il être un moyen de guérir les blessures transgénérationnelles, dans la mesure où il se situe dans la recherche d’une mobilisation… sensibilités ? Afin d’approcher certaines réponses, j’ai choisi de réfléchir à des aspects spécifiques des œuvres Portraits créoles III, de l’artiste barbadienne Joscelyn Gardner (2012) ; et du roman autobiographique Moi, Tituba, sorcière noire de Salem (Condé, 1986/2014), de la Guadeloupéenne Maryse Condé. Ce sont deux œuvres qui proposent un discours basé sur la vision de la femme afro-caribéenne.
La production artistique de ces deux femmes se construit dans un dialogue franc avec les réalités sociales dont font partie chacune d’entre elles – ou dont elles parlent – et reconstruit la signification réduite au silence de leurs histoires culturelles en impliquant leur propre subjectivité dans les formes d’expression et de narration. Elle ne constitue pas seulement un moyen de montrer de manière frappante la douleur interne, individuelle et collective des femmes de l’époque, mais devient également médiatrice de discours, d’émotions, d’expériences et d’actions qui actualisent les débats sur les asymétries persistantes et qui peuvent aujourd’hui laisser place à des processus de résilience.
Travailler sur le conflit par le biais de l’art comme moyen d’établir un lien avec les réalités vécues par les sujets subalternes est nécessaire pour libérer le poids de l’histoire et la charge négative qui la constitue; la resignifier par une approche artistique est une manière de construire des processus de résilience chez les nouvelles générations, de dévoiler la mémoire cachée ; resignifier le présent est une manière symbolique de réparation dans la mesure où il existe un lien étroit entre la mémoire et l’art. C’est aussi l’occasion de mieux comprendre le passé à travers l’humanisation des personnages, leur vie quotidienne – l’histoire avec un petit « h ». Ce n’est pas seulement ce qui s’est passé qui est violent : la dissimulation de l’événement elle-même est une violence qui perpétue l’asymétrie, l’injustice, et peut nous condamner à la répétition. La dévoiler, à travers les actions d’un artiste situé, qui questionne sa place dans l’histoire afin de se définir dans un dialogue avec et pour sa réalité, qui sera ensuite exprimée dans son propre discours, resignifiée, problématisée, est une voie vers la guérison des injustices et des inégalités historiques. Dans ce qui suit, j’analyserai ces œuvres à partir de petits détails sélectionnés dans les œuvres, à la lumière des liens entre art, culture et politique dans une perspective décoloniale, perspective antiraciste et dépatriarcale qui place les femmes noires à l’avant-scène.
Gardner, lithographies de la réexistence
Portraits créoles III fait partie d’une série de lithographies que Joscelyn Gardner développe depuis 2000. Ce groupe de 13 œuvres est composé de portraits de femmes afrodescendantes portant diverses tresses dans les cheveux, reliées à des objets de contrôle corporel – jougs, chaînes et ceps – qui étaient utilisés comme punition pour les femmes esclaves accusées d’avoir interrompu leur grossesse. Cette composition comprend des aquarelles colorées à la main de 13 spécimens botaniques auxquels on attribue des propriétés avortives. (3)
.
L’ensemble des impressions évoque une sorte d’utérus, étant donné la forme des trois éléments qui les composent mais, en même temps, sans perdre l’individualité de chacun d’eux, il est possible de visualiser un discours qui part du tressage pour parler du corps féminin, du cep pour parler du contrôle exercé sur lui et de la plante comme symbole de la réponse à ce contrôle. En d’autres termes, un récit plastique sur l’esclavage, mais aussi sur sa résistance.

Gardner, à travers la composition très simple de ces trois éléments – la tresse, le cep et la plante – qui ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres, nous présente un jeu entre l’individualité et l’universalité de femmes qui n’ont pas existé dans le récit de l’historiographie officielle, mais qui sont amenées à notre époque dans une sorte de réexistence à travers l’art.
L’artiste barbadienne ne nous montre pas les visages des femmes qui ont protégé leurs corps, mais elle nous donne leurs noms ; elle maintient leur anonymat, comme quelqu’un qui respecte l’histoire qui a été racontée en secret, en nous montrant seulement l’arrière de leurs têtes, mais en même temps elle distingue la femme asservie en soulignant sa façon unique de se coiffer, en associant son nom à une plante, ce qui non seulement orne et embellit l’œuvre, mais parle aussi de la connaissance et de l’utilisation de la botanique que les femmes asservies possédaient. Chacune des gravures imprime sa personnalité aux femmes qui sont désormais les protagonistes, et nous montre, en même temps, l’usage qu’elles faisaient de leur corps grâce à leur propre savoir.
D’autre part, l’irruption des ceps dans la composition de la pièce raconte les horreurs objectivées du régime esclavagiste en distinguant également les différents types d’instruments avec lesquels les punitions étaient infligées aux esclaves, en l’occurrence celles accusées d’avoir avorté. Les ceps, chaînes et jougs apparaissent en gris, par contraste avec le reste des éléments de la gravure, dans une sorte de une sorte de présence sombre et cruelle.
Clarissa, Yara, Prue, Sibylle, Catherine la Vieille, Yabba, Mirtilla, Abba, Nago Hanah, Quamina, Mazerine, Nimine, Lilith, des noms d’êtres humains, de femmes qui appartiennent à un horizon culturel par leur signe esthétique, apparaissent associées aux plantes abortives de l’époque, peintes en couleur à l’aquarelle. Une belle fleur, apparemment inoffensive, se détache dans le dessin de chaque pièce, mais en réalité elle possède de puissants pouvoirs sur la vie et la mort de ceux qui savent l’utiliser. Ce n’est pas un hasard si l’artiste associe le nom de chaque esclave à une plante, à laquelle elle ajoute également le nom scientifique à la manière des études naturalistes de l’époque. Dans ce cas, il s’agit également de l’oppression des femmes blanches privées d’éducation. De cette manière, Gardner met en lumière la façon dont les femmes africaines et leurs descendants ont construit la connaissance de leur environnement, en développant une vaste connaissance ethnobotanique, de la profession de sage-femme, et de la relation holistique entre la vie et la mort.
La créativité et la variété des formes de coiffures montrées dans les gravures, le caractère dense et opaque des ceps, chaînes et jougs auxquels ils sont attachés, et les délicats mais puissants spécimens botaniques finement colorés à l’aquarelle, dans le prolongement de ces instruments de contrôle corporel, font de cette œuvre une proposition de réexistence des femmes afro-caribéennes asservies.

Le travail de Gardner reconstruit l’histoire d’une forme d’agir, de ces femmes subissant une condition d’asservissement, et qui ont quand même choisi de prendre des décisions sur leur corps, en renonçant à la vie future de leurs fils et de leurs filles afin de ne pas en faire profiter le maître. La série Portraits créoles III est une proposition esthétique qui met en évidence une interaction entre la visibilisation et la singularisation des femmes qui ne jouent pas un rôle de premier plan dans le récit historiographique ; il s’agit d’un jeu entre leur anonymat et la dotation d’une identité par la singularisation esthétique de leurs cheveux. L’assujettissement et la résistance, malgré le nécrocontrôle externe que l’esclavage et le viol signifiaient pour la reproduction de la main-d’œuvre asservie, sont inscrits dans une nouvelle subjectivité. L’horizon des actions possibles malgré la condition d’assujettissement d’une femme asservie dans les Caraïbes barbadiennes et le reste des Amériques, s’élargit.
Condé, autobiographie d’un savoir
Moi, Tituba, sorcière noire de Salem est l’histoire d’une femme noire née libre sur l’île de la Barbade, après avoir été engendrée à la suite d’un viol par un marin anglais lors du voyage transatlantique sur le bateau négrier. L’histoire de Tituba, guidée par l’afro-caribéenne Maryse Condé, son autrice, est la vision du régime esclavagiste à partir de la subjectivité d’une femme africaine qui souffre, aime, vit et persiste même après sa mort comme la voix présente d’une ancêtre. Depuis ses différentes conditions, libre ou asservie ; depuis sa position d’amante sans liens de genre, d’âge ou de condition, ou comme grande connaisseuse du monde spirituel et des plantes, Tituba nous montre le quotidien cruel de la société des esclaves et ses sentiments face à cette barbarie. Maryse Condé remet en question les imaginaires construits dans la société et dans les milieux universitaires sur les noirs et les femmes asservies. Par exemple, elle nous parle des marrons qui trahissent leurs frères d’ascendance africaine ; des blancs pauvres et désavantagés dans la structure sociale ; des domestiques réduits en esclavage dans le cadre de la traite des esclaves ; d’esclaves domestiques habiles et rusés qui utilisaient la servilité comme une ruse pour gagner des marges de manœuvre et la liberté ; des esclaves qui jouissaient de leur sexualité malgré les limites imposées par l’asservissement ; et, bien sûr, des sentiments contradictoires concernant la maternité chez les femmes noires et blanches.
Dans ce roman, nous sommes témoins des abus que le système esclavagiste infligeait aux femmes noires, par le biais de fausses accusations – qui sont au cœur du roman -, de passages à tabac, de viols, de décès et, surtout, par le contrôle de leur corps. Tout ceci l’a amenée à prendre des décisions qui ont perturbé la volonté d’être mère, voire l’ont remise en question, interrogeant le sens de la vie et de l’espoir, niant ainsi l’amour maternel pour sa propre progéniture. Afin d’illustrer ce point, examinons un passage du roman dans lequel Tituba, après avoir été témoin de la pendaison d’une femme accusée d’être une sorcière et revivre ainsi les souffrances qu’elle avait endurées dans son enfance quand elle fut témoin du meurtre semblable de sa mère, nous avoue : « C’est juste après cet incident que j’ai réalisé que je portais un enfant dans mon ventre et que j’ai décidé de le tuer. » (Condé, 1986/2014, p. 65). Nous savons déjà quel genre de monde les femmes réduites en esclavage ont subi pour qu’elles soient amenées à décider de se priver de l’amour maternel de leur plein gré. Nous connaissons également l’ampleur des souffrances qu’elles ont endurées et qui leur ont fait penser que la mort était la seule alternative à l’enfer sur terre. Les lignes suivantes du roman semblent mieux l’expliquer : » Dans ma triste existence, à l’exception des baisers volés à Betsey [la petite fille de Maître Samuel Parris] et des secrets échangés avec Elizabeth Parris [la femme de Maître Parris], les seuls moments de bonheur étaient ceux que je passais avec John Indiano [le mari de Tituba] » (Condé, 1986/2014, p. 65). Tituba le détaille comme suit comme suit :
Pour une esclavisée, la maternité n’est pas un bonheur. Cela revient à expulser dans un monde de servitude et d’abjection un enfant innocent dont elle ne pourra changer le destin. Dans mon enfance, j’avais vu des esclavisées assassiner leur nouveau-né en plantant une longue épine dans l’œuf encore gélatineux de leur petite tête, ou en coupant le cordon ombilical avec un couteau enduit de poison, ou en les abandonnant la nuit dans un lieu fréquenté par des esprits irrités. Durant mon enfance, j’avais entendu les esclavisées échanger des recettes de potions, de lavements, d’injections qui stérilisent à jamais les utérus et les transforment en tombes tapissées de linceuls écarlates [c’est nous qui soulignons] (Condé, 1986/2014, pp. 65-66).
Ce fragment, en plus de nous parler des contradictions que les femmes asservies vivaient autour des sentiments de la maternité et de la décision de faire mourir les fils et les filles qui naissaient, nous montre une large connaissance développée sur le corps humain, les plantes et le spirituel. C’est précisément ce savoir que la protagoniste a appris dès son plus jeune âge grâce à une femme qui l’a recueillie alors qu’elle était orpheline, c’est ce qui la fait souffrir tout au long de sa vie mais aussi ce qui lui permet de rester connectée à ses ancêtres et de profiter des moments privilégiés de sa sexualité. Tituba est une sorcière parce qu’elle connaît. Parce qu’elle connaît son environnement, parce qu’elle sait comment soigner avec les herbes : parce qu’elle connaît la force spirituelle qui les habite et peut communiquer avec le monde des morts en permanence. La politique de faire mourir comme logique du pouvoir, économiciste, n’a pas seulement exterminé les gens, n’a pas seulement confiné, utilisé, abusé, maltraité, divisé, violé et exploité les corps, mais a également soutenu une pratique constante d’extermination intellectuelle, en éliminant les connaissances que les êtres humains asservis construisaient constamment dans la quête incessante d’exister.
Mémoires dansantes : proposition d’un récit insurgé en mouvement.
Ces récits, ainsi que mes propres expériences autour des subjectivités des femmes asservies – comme celle que j’ai vécue au Ghana – et la lecture des travaux d’autres femmes afro-caribéennes comme Michaelle Ascencio (2002) et Fabienne Kanor (2009) ont donné lieu à la construction d’un projet intitulé Memorias danzadas – Mémoires dansées.
Il s’agit d’un processus créatif qui vise à resignifier et à représenter le passé des femmes asservies des Caraïbes à travers les traditions de danse de l’expression afro-diasporique. Sous ma direction, des femmes ayant une grande expérience de la danse traditionnelle vénézuélienne et de la danse d’expression afro-contemporaine et afro-brésilienne, ainsi que de la musique afro-diasporique, ont décidé de se réunir une fois par semaine à Caracas, au Venezuela, à partir de septembre 2018, non seulement pour générer des réseaux de soutien entre nous, mais aussi pour créer, à travers le langage de la danse, des histoires qui parlent de nos expériences actuelles en dialogue avec le passé. Nous réunir pour former ce qui s’appellera plus tard Trama-Danza – Collectif de recherche, de création et de promotion de Danses Afrodiasporiques.
Trama-Danza a été créé avec l’intention de d’explorer de nouveaux défis interprétatifs dans la danse et la musique autour d’un thème profondément complexe : les femmes qui découvrent la vie d’autres femmes, les esclavisées. Beaucoup d’entre nous sont également d’accord pour dire qu’elle est née de la nécessité de guérir des blessures comme celles que j’ai vécues au château d’Elmina au Ghana, de manière transgénérationnelle, et à travers le corps et le mouvement.
J’ai décidé d’explorer, par le biais de méthodes artistiques et de recherches documentaires de première et deuxième sources, les moyens de nommer et de rendre visibles les histoires de corps et de voix réduits au silence avec des rythmes traditionnels afro-vénézuéliens, tels que le chimbanguele, le culo’e puya, le mina et les rythmes des tambours du centre du pays. Parallèlement, j’ai puisé dans les techniques de danse contemporaine d’expression africaine et afro-brésilienne pour explorer les mouvements et les gestes. Ce langage de la danse a été le contexte et la plate-forme de la construction fictive des personnages et du fil narratif de la pièce. Humus, le roman de Fabienne Kanor, a servi de base dramatique et contextuelle pour donner vie à nos personnages.
Dans un dialogue avec les expériences quotidiennes, les sentiments et les situations concrètes de chacun, les interprètes se sont immergées dans les subjectivités des cas/personnages qu’ils étudiaient et qu’ils ressentaient à partir du roman Humus au début du voyage transatlantique, et dans les documents d’historiennes telles qu’Evelyne Laurent-Perrault, Dora Dávila Mendoza et Inés Quintero tout au long du XVIIIème siècle.
Au cours de ce processus, les corps blessés, les récits réduits au silence, les âmes fortes des femmes qui ont assumé leur liberté, leurs joies, leurs peines et leurs réussites sont sortis de l’anonymat pour trouver leur avenir auprès de celles d’entre nous qui les ont défendues. Les danses racontent l’insistance des femmes déterminées à être des personnes au milieu du régime esclavagiste. Le corps était le support et le véhicule de ce récit d’un passé peu exploré : le monde subjectif des femmes en condition d’asservissement. Contrairement à la politique de la mémoire basée sur des structures, des moments, des musées, etc., le défi était ici d’utiliser le langage symbolique de la danse pour animer le passé, et le corps comme réservoir de mémoire.
Bien qu’encore inachevé, Memorias danzadas a eu un impact sur la subjectivité des interprètes, sur leurs processus personnels de reconstruction du moi, sur leur vie professionnelle et militante. Je crois qu’il est nécessaire de citer leurs voix comme témoignages de la façon dont l’art et la politique se combinent pour la transformation. Par exemple, Merlyn Pirela, une interprète de danse, de chant et de texte, mentionne ce qui a changé pour elle à la suite de cette expérience : « Mon identité afro-vénézuélienne, le travail d’auto-reconnaissance ethnique, mais cette fois-ci à partir de la pratique : lecture de Humus, recherche de l’auteur Fabienne Kanor, création de personnages, dont mon préféré : l’Amazone » (2021). Judith Ruda, danseuse, commente la dimension réparatrice du projet, tant sur le plan symbolique que spirituel:
Ce projet, pour moi, a été la possibilité de m’impliquer, de mieux connaître et d’approfondir ces processus du thème transgénérationnel, de mes ancêtres et de tout ce qui concerne la condition migratoire de beaucoup d’entre eux, aussi bien espagnols qu’africains, encore plus en ce qui concerne la situation des femmes ou de ces ancêtres féminines qui, au cours du XVIIIème siècle, ont été réduites au silence, exclues et qui, souvent contre leur gré, sont arrivées en Amérique, amenées par nos ancêtres espagnols (2021. Personnage représenté par elle : la vieille femme).
Dans le même ordre d’idées, mais en soulignant la force des processus collectifs dans la reconstruction de la diaspora africaine, Jaheli Fuenmayor, interprète de danse, souligne :
Je suis reconnaissante pour cet accompagnement imaginaire…. Non seulement il me renforce, mais j’y crois et il me touche. Je sens qu’il y a quelqu’un quelque part qui m’aide et qui le fait par gratitude. Qui le fait parce qu’elle me remercie d’avoir pris la peine de penser à ce qui a pu lui arriver, à ce qu’était sa vie, qu’un peu de justice soit rendue (2021. Personnage représenté par elle : la Blanca).
Enfin, je voudrais conclure cet essai par l’interprétation de notre travail faite par Valentina Curcó, la graphiste du projet, pour construire le dossier de la pièce. L’image qui représente Memorias danzadas est une relecture par Curcó de l’œuvre Portrait d’une femme noire, peint en 1800 par l’artiste Marie-Guillemine Benoist et conservé au Musée du Louvre à Paris, France. Curcó a fait le lien avec certains des textes sur lesquels elle a travaillé pendant le processus, des gravures de femmes esclaves et marronnes, des documents et leurs histoires. Elle a décidé de choisir, parmi plusieurs options, celle qui sera connue plus tard comme une nourrice martiniquaise nommée Madeleine. Voyons comment Valentina la sort à nouveau de l’anonymat, poussée par la force de la mer et accompagnée par la force d’autres femmes qui, comme elle, n’ont pas succombé à l’histoire (figure 1).
Bien que les œuvres présentées ici soient réalisées par une seule personne, elles ne sont pas confinées à l’univers individualiste qui a caractérisé une grande partie du discours sur l’art moderne, une production sublime érigée par la condition extraordinaire d’un sujet qui, abstrait de son monde de vie, produit l’extraordinaire. Au contraire, l’engagement des récits de ces femmes révèle un dialogue et une remise en question des hiérarchies d’oppression que chacune d’entre elles vit ou auxquelles elle participe par tradition culturelle. Cela les place, à mon avis, dans un sens communautaire de l’art, situé, interrogeant et transformant dans la Caraïbe. C’est précisément dans ce sens que le caractère de l’art caribéen est une approche collaborative, dans la mesure où il est tracé dans une logique qui résonne pour celles et ceux qui le construisent, parce qu’il parle des sujets eux-mêmes. Cela place immédiatement la production dans une rupture des canons hégémoniques, car elle permet de donner la parole à celles et ceux qui ont été rendus invisibles. En fin de compte, elle les convertit en récits féminins codifiés de différentes manières dans les arts plastiques, la littérature, la danse et le graphisme, situés dans des lieux différents et des moments historiques particuliers, mais qui insurgent avec une seule intention : la revendication des femmes qui ont refusé d’être anéanties en tant que personnes.
Notes :
(1) Cet essai est une version augmentée et améliorée de la communication intitulée Interrumpir la vida esclavizada – liberar el alma de un(a) hijo(a) : uso político del cuerpo de la mujer negra en condición de sujeción, exposée lors de la première Jornada de Historia Feminista, Centro Nacional de Historia, Caracas, 22 novembre 2018.
(2) Afro-vénézuélienne. Docteure en anthropologie. Chercheuse et activiste dans les domaines des identités politiques afro-diasporiques en contextes coloniaux et post-coloniaux, et leur articulation avec la religion, le corps, la nourriture et la mémoire sociale. Interprète, professeure et chercheuse en danse traditionnelle vénézuélienne. Activiste à Trenzas Insurgentes – Colectivo de Mujeres Negras, Afrovenezolanas y Afrodescendientes ; et à La Alpargata Solidaria – Sistema de Intercambio Solidaria Solidaria – Système d’échange solidaire de Caracas.
(3) Les treize lithographies de Portraits Créoles III sont visibles sur le site web de l’artiste : https://www.joscelyn-. gardner.org/creole-portraits-iii (Gardner, 2012).
Références:
Dueñas, G. (1996). Infanticidio y aborto en la Colonia. Pócimas de ruda y cocimientos de mastranto. En Otras Palabras, (1), 43-48.
Fanon, F. (1973). Piel Negra, Máscaras Blancas
(Trad. A. Abad). Editorial Abraxas. (Trabajo original publicado en 1952)
Farnell, B. (1999). Moving bodies, acting selves. Annual Review of Anthropology, 28, 341-373. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.28.1.341
Féres da Silva Telles, L. (2018). Teresa Benguela e Felipa Crioula estavam grávidas: Maternidade e escravidão no Rio de Janeiro (século XIX) [Tesis de doctorado, Universidade de São Paulo]. Biblioteca Digital USP, Teses e Dissertações. https://doi.org/10.11606/T.8.2019.tde-24072019-
152856
García, J. C. (1989). Contra el cepo: Barlovento tiempo de cimarrones. Lucas y Trina.
García, J. C. (1996). Africanas, esclavas y cimarronas. Fundación Afroamérica;
CONAC.
García, J. C. (2005). Aportes morales y políticos de los africanos a las ideas de libertad, igualdad y fraternidad en Venezuela y América Latina y el Caribe. En N. Ramos (Ed.),
Resonancias de la africanidad (pp. 117-123). Fondo Editorial IPASME.
Gardner, J. (2012). Creole Portraits III: “bringing down the flowers”. Joscelyn Gardner. https://www.joscelyngard-ner.org/creole-portraits-iii
Glissant, É. (2005). El discurso antillano. Monte Ávila Editores Latinoamérica.
Arrelucea, M. (2007). Lágrimas, negociación y resistencia femenina: esclavas litigantes en los Tribunales. Lima, 1760-1820.
Revista Summa Historiae, (2), 85-102.
Ascencio, M. (2002). Amargo y dulzón. Casa Nacional de las Letras Andrés Bello.
Benoist, M.-G. (1800). Portrait d’une femme noire [Pintura]. Museo del Louvre, París, Francia.
Brito Figueroa, F. (1990). Venezuela colonial: las rebeliones de esclavos y la Revolución Francesa.
Caravelle, (54), 263-289.
Condé, M. (2014). Yo, Tituba, bruja negra de Salem (Trad. A. Hernández). Monte Ávila Editores Latinoamericana. (Trabajo original publicado en 1986)
Csordas, T. J. (Ed.). (1994). Embodiment and experience: The existential ground of culture and self. Cambridge University Press.
Cuero Montenegro, A. Y. (2017). El teatro como intervención feminista antirracista. Reflexiones en torno a las obras de teatro Raíz de ébano y Flores amarillas.
Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, 15(2), 48-59. https://doi.org/10.29043/liminar.v15i2.529
Dávila Mendoza, D. (2009). La sociedad esclava en la Provincia de Venezuela, 1790-1800 (Solicitudes de libertad-se-lección documental). Universidad Católica Andrés Bello.
Díaz, A. J. (2004). Female citizens, patriarchs, and the law in Venezuela, 1786- 1904. University of Nebraska Press. Año 10 fln.o 15fi, 2021, ISSN: 2305-7467
Gutiérrez Urquijo, N. M. (2009). Los delitos de aborto e infanticidio en Antioquia, 1890-1930.
Historia y Sociedad, (17), 159-177. https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/
view/20445
Halliburton, M. (2002). Rethinking anthropological studies of the body: Manas and Bōdham in Kerala. American Anthropologist, 104(4), 1123-1134. http://www.jstor.org/stable/3567101
Hernández Reyes, C. E. (2018). Aproximaciones al sistema de sexo/género en la Nueva Granada en los siglos XVIII y XIX. En A. Vergara Figueroa y C. L.
Cosme Puntiel (Eds.), Demando mi libertad. Mujeres negras y sus estrategias de resistencia en la Nueva Granada, Venezuela y Cuba, 1700-1800 (pp. 30-75). Universidad ICESI; CEAF.
Kanor, F. (2009).
Humus. Monte Ávila Editores Latinoamérica; Embajada de Francia en Venezuela.
Laurent-Perrault, E. (2012). El debate público de l@s afro-descendientes en la Provincia de Caracas, Venezuela. 1790-1810 [Ponencia]. Universidad Católica Andrés Bello, Estudios de Postgrado en Historia, Caracas, Venezuela.
Laurent-Perrault, E. (2015). Black honor, intellectual marronage, and the law in Venezuela, 1760-1809 [Tesis de doctorado, New York University]. NYU Libraries. https://bobcat.library. nyu.edu/primo-explore/fulldisplay?-docid=nyu_aleph005982186&con-text=L&vid=NYU&lang=en_US&-search_scope=all&adaptor=Lo-cal%20Search20Engine&tab=all&-query=any,contains,laurent-perraul-t&offset=0
Laurent-Perrault, E. (2018). Esclavizadas, cimarronaje y la ley en Venezuela, 1770-1809. En A. Vergara Figueroa y C. L. Cosme Puntiel (Eds.), Demando mi libertad. Mujeres negras y sus estrategias de resistencia en la Nueva Granada, Venezuela y Cuba, 1700-1800 (pp. 77-108). Universidad ICESI; CEAF.
Lock, M. (1993). Cultivating the body: Anthropology and epistemologies of bodily practice and knowledge. Annual Review of Anthropology, 22, 133-155. https://doi.org/10.1146/annurev.
an.22.100193.001025
Moscoso, F. (1995). Formas de resistencia de los esclavos en Puerto Rico, siglos XVI-XVIII.
América Negra, (10), 31-48.
Quintero, I. (2008). La palabra ignorada. La mujer: testigo oculto de la historia en Venezuela. Fundación Empresas Polar.
Rojas, N. (2014). Las Criollas y sus trapos. Matices de la moda femenina caraqueña durante la segunda mitad del siglo XVIII. En N. R. Ochoa Hernández y J. Flores González (Comps.), Se acata pero no se cumple. Historia y sociedad en la Provincia de Caracas (siglo XVIII) (pp. 217-287). Centro Nacional de Historia; Archivo General de la Nación.
Soto Lira, R. (1992). Negras esclavas. Las otras mujeres de la Colonia. Proposiciones, 21, 21-31.
Taylor, S. E. (2011). Negotiating honor: Women and slavery in Caracas, 1750-1854 [Tesis de doctorado, University of New Mexico]. UNM Digital Repository. https://digitalrepository.unm.edu/hist_etds/75.
Ugueto-Ponce, M. (2015). Estudio comparativo de dos casos de pueblos fundados por negros libres: Curiepe, Venezuela y San Mateo de Cangrejos, Puerto Rico [Tesina de diplomado, Instituto
de Altos Estudios Diplomáticos «Pedro Gual» / Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora]. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16668.74882
Vergara Figueroa, A. y Cosme Puntiel, C. L.(2018). Demando mi libertad. Mujeres negras y sus estrategias de resistencia en la Nueva Granada, Venezuela y Cuba, 1700-1800. Universidad
ICESI; CEAF.
Zambrano, A. (2014). Las cenizas del amor. Matrimonio, divorcio y malos tratos a las mujeres casadas en la Provincia de Caracas (siglo XVIII). En N.R. Ochoa Hernández y J. Flores González (Comps.), Se acata pero no se cumple. Historia y sociedad en la Provincia de Caracas (siglo XVIII) (pp. 289-343). Centro Nacional de Historia; Archivo General de la Nación.
Traduit de l’espagnol pour Venezuelainfos par Thierry Deronne
URL de cet article : https://venezuelainfos.wordpress.com/2023/02/03/le-venezuela-au-fond-des-yeux-7-les-memoires-dansees-de-meyby-ugueta-ponce/







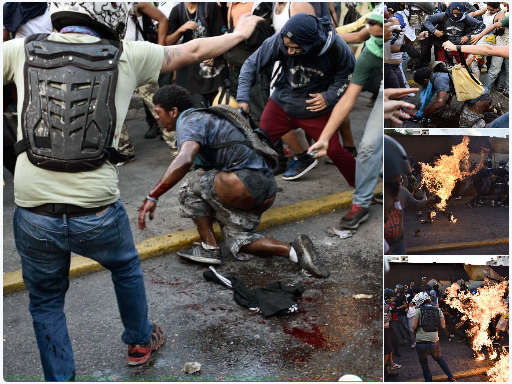








 « Séchons avec le feu sacré de notre conscience, séchons les larmes de l’Afrique, mais également celles de l’Amérique latine, pour que… les pleurs de nos siècles se
« Séchons avec le feu sacré de notre conscience, séchons les larmes de l’Afrique, mais également celles de l’Amérique latine, pour que… les pleurs de nos siècles se













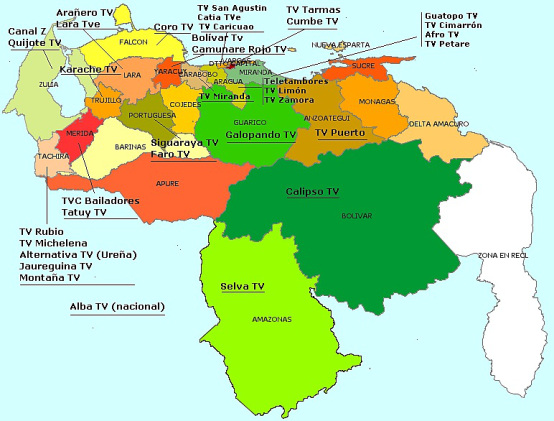







Vous devez être connecté pour poster un commentaire.